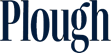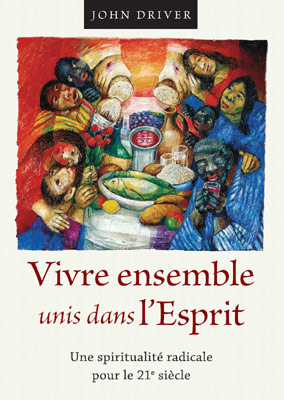Subtotal: $
Checkout
L’abîme de la beauté
L'art de voir le monde naturel
par Ian Marcus Corbin
mercredi, le 16 juin 2021
Autres langues: English
L’article suivant:
Albert Camus écrivit : si l’on est vraiment attentif, la beauté, malgré son charme, est « insupportable ». La beauté, dit-il, « nous pousse au désespoir, en nous offrant pour un instant l’aperçu d’une éternité que nous voudrions étendre sur le temps tout entier ».
Pour la plupart d’entre nous, la déclaration de Camus semble douteuse ; elle a des relents de fiction poétique tragique. Nous pouvons ressentir de la répulsion ou du désespoir à la vue de la misère et de la mort. Mais la beauté ? Quelle sorte de douleur pourrait accompagner l'appréhension d'un coucher de soleil ou d'une fleur ?
Et pourtant, on a vite fait de se demander s’il a peut-être raison, car il est bien rare qu’on regarde réellement. On a tendance à chercher les choses plutôt qu’à les regarder, à les identifier juste assez longtemps pour savoir si elles vont nuire ou être utile, pour savoir ce dont nous avons intérêt à nous détourner, ce que nous devrions ramasser par terre et empocher pour le lendemain.
Un après-midi de l’été dernier, j’étais assise sur un banc dans un petit parc urbain, mon plus jeune fils Leonard endormi dans sa poussette. J’avais délibérément choisi de laisser mon iPhone à la maison, bien décidée à regarder autour de moi. C’est un projet éthique permanent, un mode de vie auquel j’aspire et qui est trop rarement atteint. J’ai toujours eu l’impression que je pourrais vraiment, profondément aimer la vie, ou au moins une journée voire un après-midi, si je pouvais simplement me taire et regarder, interrompre les incessants calculs, inquiétudes et raisonnements. Lorsque Gerard Manley Hopkins s’assoit tranquillement, il trouve que le monde naturel est « imprégné de la grandeur de Dieu » et il exulte en sachant que ses « braises bleuâtres » « tombent, se gercent et entaillent le vermillon d’or ». Eh bien, c’est ce que je veux. Je veux voir des braises, bleuâtres et mourantes, voir que, lorsqu’elles tombent et se vident, le vermillon doré s’étend dans le monde visible.

Peer Christensen, Étude du pommier sauvage, huile sur toile, détail, 2020. Utilisé avec permission.
En quoi cela serait-il différent de ma vie actuelle faite de voitures, de trottoirs et d’échanges de textos, de longues nuits agitées à me retourner dans mon lit en proie à mes pensées ? Peut-être pourrions-nous apprécier la vie en la voyant vraiment.
D’un autre côté, peut-être que, si nous regardons vraiment, ce que nous verrons sera cruel, insupportable. Dans le petit parc, mes yeux se sont posés sur un arbre dont les branches s’étendaient au-dessus de la clôture en mailles de chaîne d’une petite zone non cultivée à l’extérieur. C’était le mois d’août ; les feuilles étaient épaisses et vibrantes, presque luxuriantes, et l’on sentait derrière elles le soleil brûlant de cet après-midi. Aux extrémités de ses branches pendaient d’épaisses grappes de globes de la taille d’un petit pois, une sorte de véhicule de reproduction, porteur de la prochaine génération, si tenace dans nos villes, de l’arbre à mauvaises herbes. La chose la plus normale au monde.
Mais privé que j’étais de tout ce qui est plus urgent à regarder, mes yeux se sont calmés et, à la faveur de cette nouvelle tranquillité, l’arbre s’est présenté à moi dans toute sa plénitude. Il est devenu merveilleux, chargé de cette lourde et prolifique suspension de virtuose ; nichée dans ce coin ignoré, sans surveillance, il déployait ces riches et éclatantes grappes de germes vert cireux. Tant de plénitude, tant de nouveauté gratuite, la production d’une plénitude – une nouvelle vie – comme jamais je ne pourrai en concevoir dans l’agitation de mon esprit et de mes mains.
Je l’avoue, j’ai quelques tendances au romantisme, et j’étais captivé. Tant de choses, tant de richesse dans cette petite explosion de branches, non planifiée. Je n’avais aucun intérêt pratique pour ces graines, si du moins c’était des graines d’ailleurs. Mais je voulais les garder sous mes yeux. C’était trop beau pour m’en détourner avec indifférence. Cette riche rondeur – quelle merveille que cela puisse exister ! Je m’émerveillais devant cette beauté inexplicable, insoupçonnée. Je voulais la posséder pour toujours, vivre en quelque sorte en sa présence. La vie, je le sentais fortement, est meilleure que celle que je vis normalement au quotidien.
Et pourtant, qu’est-ce que cela pouvait bien vouloir dire ? Que pouvais-je faire ? Ces petites graines pendaient là pour une semaine ou un mois ; elles ne réussiraient probablement pas à engendrer un autre arbre. Elles tomberaient et se flétriraient ; à présent, elles ont certainement déjà pourri en terre. J’ai soudain ressenti de la consternation, voire du désespoir. J’étais trop loin d’eux ; j’ai même du mal aujourd’hui à me souvenir de leur apparence. Les voir était une torture, une provocation. En rentrant chez moi, je me suis souvenu de « Fruit », écrit par l’un de nos grands guides modernes en ces matières, le poète polonais Adam Zagajewski :
. . . Inaccessibles
ces après-midi, mûrs, tumultueux, ces
feuilles gorgées de sève, ces fruits gonflés,
les soies des passantes qui bruissent de
l’autre côté de la rue ; l’éclat de la lumière
et les cris des garçons qui sortent de l’école.
Inatteignables. La pomme la plus simple ?
Une rondeur impénétrable. Les couronnes
des arbres s’agitent au gré des courants
d’air chauds. Au loin, des montagnes
inaccessibles. Des arcs-en-ciel impalpables.
D’immenses falaises de nuages progressant
lentement dans le ciel. Cet après-midi
somptueux, inatteignable. Ma vie,
tourbillonnante, inaccessible, libre..
Quelle étrange sorte d’animal nous devons être, pour nous sentir perchés à la périphérie de quelque chose, toujours seulement presque vivant. Cette chose devant nous, à peine hors de notre portée, semble idéale, si seulement nous pouvions l’atteindre. Mais le pouvons-nous ? Une telle intimité existe-t-elle ? Est-ce trop demander que de l’espérer ?
Quelle étrange sorte d’animal nous devons être, pour nous sentir perchés à la périphérie de quelque chose, toujours seulement presque vivant.
Camus le sait, et il est triste, mais courageux. Ce que sait Hopkins est différent, et il en titre une réserve de gratitude. Pour lui, chaque petite grappe de baies est chargée de grandeur spirituelle, car « le Saint-Esprit, au-dessus du monde courbé, le couve sous sa poitrine chaude et ses ailes brillantes ». Camus, lui aussi, semble avoir entrevu une ombre de divinité dans les jupes de la beauté matérielle – c’est précisément une « éternité » insaisissable, illusoire, qui le blesse car il sait que c’est en vain qu’il espère qu’elle reste. Zagajewski voit aussi cette ombre, mais il ne sait pas vraiment, pas comme Camus et Hopkins. Sa connaissance est une poétique, une esthétique, voire une spiritualité chargée de nostalgie et de générosité – il sait peu de choses, refuse de perdre espoir, est conserve une honnêteté implacable. En lui, je me retrouve, par intermittences.
Cependant, tout le monde n’est pas coincé dans les limbes. Certaines personnes savent, ou du moins croient savoir. Mais comment ? J’ai passé bien plus d’une décennie à examiner ces questions avec les outils de la philosophie, et je sais au moins que les arguments invoqués ne sauraient apporter de réponse. Peut-être trouverons-nous l’esquisse d’une piste en étudiant l’histoire de Václav Havel, écrivain et intellectuel tchèque influent dans le monde des arts et des lettres underground de la Tchécoslovaquie soviétique. En 1989, il a contribué à fomenter la « révolution de velours » antisoviétique, sans effusion de sang, avant de devenir président. Dix ans auparavant, Havel avait été arrêté pour subversion et condamné à une peine de quatre ans de prison. Un jour, dans la cour de la prison de Heřmanice, il eut une épiphanie radicale qui s’apparenta à une expérience de conversion. Voici ce qu’il écrivit à sa femme, Olga :
J’ai ressenti un sentiment de réconciliation, en fait un assentiment presque réconfortant avec le cours inévitable des événements tel qu’il m’était révélé maintenant. Cette impression se conjuguait avec une détermination insouciante à faire face à toutes les situations. Un profond étonnement devant la souveraineté de l’Être s’est transformé en une sensation vertigineuse de tomber sans fin dans l’abîme de son mystère ; une joie sans bornes d’être en vie, d’avoir eu la chance de vivre tout ce que j’ai vécu, et la conviction que tout a une signification profonde et évidente – étrangement, cette joie s’est combinée en moi avec un vague sentiment d’horreur : tout ce dont j’étais si proche restait insaisissable, impossible à appréhender à ce moment-là ; je me tenais au « bord de l’infini », inondé d’un sentiment de bonheur ultime et d’harmonie avec le monde et moi-même, avec cet instant. Avec d’ailleurs tous les instants que je me remémorais, et avec tout ce qui est invisible et a un sens. Je dirais même que j’ai en quelque sorte eu « le coup de foudre », mais sans précisément savoir pour qui ou quoi.
Cette révélation a procuré à Havel ce qu’il décrit comme « un sentiment de bonheur ultime et d’harmonie avec le monde et avec soi-même, avec ce moment, avec tous les moments qu’il se remémorait, et avec tout ce qui est invisible et qui a un sens ». Mais comment, pourquoi cela s’est-il produit ? Qu’avait de spécial cet arbre particulier – et par extension, toute belle chose ordinaire – qui pourrait expliquer ce genre d’expérience ?
Nous ne le saurons jamais, bien sûr, mais pourquoi ne pas commencer par la description de l’arbre écrite par Havel. L’arbre est « énorme », il étire ses branches avec « une dignité tranquille, vers le ciel et vers la terre, par-dessus toutes les clôtures, fils de fer barbelés, barreaux et miradors », tandis que ses feuilles « tremblent imperceptiblement » sur fond de « ciel sans fin ». Son épiphanie semble être nourrie par la juxtaposition de l’arbre et du ciel, chacun éclairant son appréhension de l’autre.
Cette ouverture, cependant, exige un certain degré de brisement, et s’avère parfois difficile et douloureuse.
Il voit les êtres vivants s’étendre avec « une tranquille dignité », dans leur excellence incessante, simple et insouciante. La fourrure du zèbre porte des rayures, ses coupures guérissent et les magnolias fleurissent au printemps. Dans la cellule la plus simple, des structures et des fonctions d’une grande complexité et d’une grande élégance opèrent indépendamment de la compréhension ou du contrôle humain. Et cette sorte de virtuosité est belle à voir, comme l’observe Aristote : « L’absence de hasard et la conduite de tout vers une fin se retrouvent au plus haut degré dans les œuvres de la nature, et la fin que produisent ses générations et ses combinaisons est une forme de beauté ».
Cette belle virtuosité va plus loin que nous pouvons l’imaginer, peut-être infiniment plus loin. Havel est frappé par « le grand et mystérieux ordre de la nature, sa propre direction ». Nos sciences, en particulier la physique, visent à tracer un fondement explicatif, un compte-rendu des forces qui sous-tendent finalement la structure et l’ordre des arbres, des mains et des cils. Or, même si nous embrassons la théorie des cordes, nous pouvons toujours nous demander ce qui explique la cohésion et la fonction de leurs minuscules cordes vibrantes d’énergie. Les êtres vivants ont des profondeur à la fois ordonnées et incompréhensibles pour les sachants humains.
Confronté au mystère, Havel est étourdi par sa propre finitude. Il constate – avec soulagement – qu’il ne peut tout simplement pas se rendre omnipotent, et qu’il ne devrait même pas essayer. C’est ainsi qu’il décrit un sentiment de « doux assentiment au cours inévitable des événements tel qu’il m’est révélé maintenant... combiné à une détermination insouciante à faire face à toutes les situations ».
Pourtant, il ressent « un vague sentiment d’horreur de comprendre que tout ce dont il était si proche à ce moment-là lui restera insaisissable et incompréhensible. J’étais si proche à ce moment-là, debout au bord même de l’infini ». Havel a compris que la quête humaine de la compréhension et de la maîtrise est vouée à la frustration permanente. Nous, les humains, faisons partie de la nature, et avons les mêmes profondeurs infinies que l’énorme arbre de Havel, mais comme connaisseurs et acteurs, nous sommes incorrigiblement limités. Ce constat doux-amer rend Havel réceptif à la merveilleuse idée que si nous ne pouvons pas tout comprendre, il y a peut-être beaucoup de choses qui nous deviennent compréhensibles.
Chaque arbre, chaque fourmi et chaque personne s’élève et tombe sous un ciel infini ; nous pouvons nous épanouir tel ou tel jour, mais le passage du temps entraînera notre anéantissement physique. La virtuosité de la vie est d’autant plus frappante – elle peut même sembler miraculeuse – qu’elle émerge dans un contexte qui met aussi en évidence sa fragilité. Nous sommes tous là, pendant quelques courtes minutes, minuscules, fragiles, ignorants, et d’une indicible beauté. Confronté à cette juxtaposition, Havel reçoit soudainement, de manière inattendue, l’intuition que, derrière la façade du flux omniprésent, il existe une réalité illimitée, incorruptible. C’est de cette réalité que la métaphysique et la théologie traditionnelles tentent de parler.
Il ne nous reste donc qu’un seul impératif : une attention humble et attentive.
Havel accepte avec gratitude son intuition, et son attitude face à la vie s’en trouve transformée, bien qu’il n’aille pas jusqu’à se déclarer converti : « je dirais même que j’ai en quelque sorte eu le coup de foudre », mais je ne sais pas exactement pour qui ni pour quoi ». Comme un certain nombre de théologiens, dont Augustin et Aquin, Havel ressent la difficulté de mettre des mots sur notre expérience de l’ineffable.
Et pourtant, contrairement à eux, il se sent incapable d’accepter toute tentative doctrinale en ce sens, bien qu’il dise dans d’autres écrits qu’il aimerait bien y arriver. Il écrit dans une autre lettre à Olga qu’« en nous percevant comme une partie de la rivière, nous acceptons notre responsabilité envers l’ensemble de la rivière ». Le ravissement esthétique de Havel ne l’éloigne pas des liens de la solidarité humaine, mais les remodèle et les renforce.
Confronté à cet instant à la juxtaposition de fragilité et virtuosité, Havel a soudain compris que la fragilité n’aurait jamais le dernier mot. Les personnes et les choses particulières sont effectivement fragiles, mais il existe une réalité spirituelle ineffable qui unit et harmonise les particularités en un tout magnifique et invulnérable. L’univers n'est pas, selon lui, froid et indifférent.
Pourquoi diable Havel en est-il arrivé à cette conclusion ? Bien que « conclusion » ne soit pas le bon mot : ce n’était pas le résultat d’une longue réflexion ou d’un faisceau de preuves. Prisonnier ordinaire, Havel est entré dans une cour poussiéreuse, et soudain la métaphysique a jailli, sans la moindre sollicitation. Et il a été emporté par sa vérité.
Je le répète : Havel n’a pas été forcé par la logique à tirer cette conclusion. Nous pouvons nous émerveiller de la virtuosité de la nature même si la fragilité a en effet le dernier mot. Mais, pour Havel, à nouveau, elle semblait ne pas devoir avoir le dernier mot. La perception d’un moment de beauté a fait boule de neige et s’est transformée en une intuition sur la beauté elle-même, qui a rassemblé et entraîné toute l’existence dans son orbite. Or, si la beauté semble parfois ouvrir une petite fenêtre sur un royaume au-delà de notre existence fragmentée et limitée dans le temps, chaque adulte sait que rien n’est toujours ce qu’il paraît. Herman Melville écrivit en 1851 à son ami Nathaniel Hawthorne :
En lisant certaines des maximes de Goethe, si vénérées par ses adeptes, je suis tombé sur ceci : « Vivez dans le tout ». C’est-à-dire que votre identité séparée n’est qu’une identité misérable – bien ; mais sortez de vous-même, étendez-vous et élargissez vos horizons ; offrez-vous les frissons de vie que l’on ressent dans les fleurs et les bois, devant les planètes Saturne et Vénus, et les étoiles fixes. Quelle absurdité !
Mais il ajoute,
N.B. Ce sentiment de « tout », cependant, a sa part de vérité. Vous avez souvent dû le ressentir, allongé dans l’herbe par une chaude journée d’été. Vous avez l’impression que vos jambes prennent racine. Vos cheveux ressemblent à des feuilles qui poussent sur votre tête. C’est cela le sentiment du tout. Mais le problème avec la vérité, c’est que les hommes insistent sur l’application universelle d’un sentiment ou d’une opinion temporaire.
Pour Havel, ce sentiment était un aperçu d'une vérité authentique, et il l'a transformé. Pour Melville, il s’agissait d’un « sentiment ou d’une opinion » temporaire, à apprécier mais pas à considérer comme une révélation. Pourquoi Melville « savait-il » que l’apparente réalité du « tout » devait être rejetée comme une chimère ? Pourquoi Havel « savait-il » qu’il fallait y adhérer ?
En tant que penseurs – qui mettent en œuvre des concepts, des techniques d’implication logique – je crains que notre champ d’investigation sur ces questions ne doive s’arrêter ici, sur une note de déception. Tout ce que nous pouvons dire avec certitude c’est que certaines expériences de la beauté donnent au monde une certaine apparence – comme s’il était « imprégné de la grandeur de Dieu », comme le dit Gerard Manley Hopkins. En revanche, pour son contemporain Matthew Arnold, le monde semble être une « plaine obscure » où « des armées ignorantes s’affrontent de nuit ».
Choisir quelle compréhension adopter comme vrai contact intime de notre expérience fondamentale de la réalité ne relève pas du tout d’une décision. Les philosophes creusent, dit Wittgenstein, jusqu’à ce qu’ils touchent la roche, et que la bêche rebondisse. La bêche rebondit contre ce dur. Comment, sur quelles bases, Havel pourrait-il convaincre Melville de croire au sentiment de tout ? Comment Melville pourrait-il convaincre Havel de ne pas y croire ? Cela ne relève pas du domaine de la confirmation ou de la réfutation logique, ni même de la persuasion. Il est plutôt question de confiance. On pourrait comparer Havel et Melville à un jeune marié recevant un serment d’amour et de fidélité de la part de sa future épouse. Doit-il la croire ? Lui seul peut prendre cette décision – pas moyen a priori de trancher. Certaines expériences ne peuvent qu’être vécues et écoutées.
Il ne nous reste donc qu’un seul impératif : une attention humble et attentive. C’est la seule façon de commencer à examiner la grande question à laquelle Havel et Melville répondent chacun à leur manière, radicalement différentes.
Le type d’attention capable d’aborder la question est peut-être celui que Simone Weil décrit comme « vide, en attente, ne cherchant rien, mais prêt à recevoir dans sa vérité nue l’objet qui doit le pénétrer ».

Peer Christensen, Étude du Tamarack, détail
L’image de Weil s’accorde très mal avec le style d’attention agressif et pénétrant qui a fait les beaux jours des Lumières. Ce style prévaut toujours comme la posture paradigmatique de l’enquête sérieuse, validée chaque jour par les avancées fantastiques de la science et de la technologie modernes. Il est parfaitement articulé dans La critique de la raison pure de Kant, lorsqu’il affirme que la raison « doit s’approcher de la nature pour en recevoir les enseignements. Elle ne doit cependant pas le faire comme un élève qui boit toutes les paroles de son maître, mais comme un juge impartial qui oblige les témoins à répondre aux questions qu’il a lui-même formulées ». Il s’agit, bien entendu, d’une manière plutôt austère et étroite d’aborder la nature, du moins lorsque nous agissons en simples humains plutôt qu’en enquêteurs scientifiques.
L’approche kantienne est progressivement devenue la manière par défaut d’appréhender le monde, contribuant ainsi à rendre plus rares des expériences comme celles vécues par Havel. L’approche de Kant a certes été marquée par les temps et le lieu qui étaient les siens, mais certains sujets – comme l’histoire de l’humanité – ne sont pas abordés : comme la nature fondamentale de la réalité, ou la probabilité d’une entente conjugale – qui exigent une approche plus ouverte, plus variée et plus sensible.
Cette ouverture, cependant, exige un certain degré de brisement, et s’avère parfois difficile et douloureuse. Le fait qu’Havel ait eu son épiphanie alors qu’il était emprisonné et impuissant n’est pas sans importance. La prise de conscience par Havel de sa finitude, sa confrontation avec un monde trop vaste par rapport à ses capacités est renforcée par l’enfermement physique. Il est difficile d’adopter la posture de Kant lorsque l’illusion de maîtrise a été détruite sans cérémonie et de manière tellement probante. Il est donc logique que des penseurs tels que Boèce, Thomas More, Wittgenstein, Pound, Dostoïevski et Martin Luther King Jr. aient écrit des chefs-d’œuvre en prison. Souffrance et humiliation sont des moyens efficaces pour nous ouvrir les yeux, c’est le fil conducteur de certaines des œuvres les plus poignantes de Dostoïevski, c’est-à-dire certaines des plus puissantes jamais créées.
Lorsque l'écrivain et polémiste athée Christopher Hitchens apprit qu’il était atteint d’un cancer, il a annoncé que s’il devait mourir dans les affres de la décrépitude, et qu’il commence à adoucir sa position à l’encontre du théisme, le public devrait ne pas en tenir compte. Le vrai Christopher Hitchens, disait-il encore, c’était cet homme robuste, combatif et physique. Le Christopher Hitchens diminué, triste, terrifié par un cancer avancé ne serait que l’ombre de l’homme dans sa plénitude. Hitchens a abordé ici une question épistémologique majeure : voyons-nous plus clairement en temps de faiblesse ou de force ? Dostoïevski répond définitivement à la première question, mais avec une réserve : le type de faiblesse qu’il trouve éclairante implique une distinction minutieuse entre honte et culpabilité.
Cette distinction est résumée dans l’histoire de Markel, personnage mineur des Frères Karamazov. Markel est un garçon hautain et cynique, qui se moque de la piété de sa mère, jusqu’à ce qu’il soit frappé par la maladie. Alors il s’affaiblit progressivement, et se sent de plus en plus humilié ; il en vient de plus en plus à embrasser la piété dont il se moquait autrefois. S’adressant à sa mère, Markel l’appelle « cœur de mon cœur, ma joyeuse », et lui déclare « savoir qu’en vérité chacun de nous est coupable devant tous, pour tous et pour tout ». Je ne sais pas comment te l’expliquer, mais je le ressens très fort, au point d’en avoir mal ». Depuis sa nouvelle perspective, Markel se tourne dans un humble repentir vers les personnes qui l’entourent et vers la création au sens large : « Il y avait tant de gloire de Dieu autour de moi : les oiseaux, les arbres, les prairies, le ciel… J’étais quant à moi le seul à vivre dans la honte, le seul à tout déshonorer, sans remarquer la beauté et la gloire de tout cela ».
Honte et culpabilité sont ici totalement opposées. La honte est un déni, un désir de cacher sa vraie nature à soi-même et aux autres. C’est ce que Hitchens imaginait que la religion pouvait être – une tentative brouillonne et pathétique d’échapper à la finitude. La culpabilité au sens de Dostoïevski c’est le contraire. C’est un lâcher-prise, la reconnaissance généreuse de notre vraie nature, l’acceptation hospitalière de ses propres défauts, de sa finitude et de sa mortalité. Cette acceptation vous libère d’un mensonge étouffant et au contraire crée la possibilité de se retrouver : avec soi-même, avec les autres, avec la nature. La mère de Markel tenta de le sauver de cette libération, en lui assurant qu’il n’est pas aussi coupable qu’il le prétend, et il le lui reproche : « Que je sois pécheur devant tout le monde, c’est l’enfer, mais que tout le monde me pardonne, et c’est le paradis. Ne suis-je pas au paradis maintenant ? » Voilà de paroles lourdes de sens et puissantes.
Au plus profond de moi, je ressens leur affirmation ; s’il existe une clé à ma rencontre surchauffée avec les fruits d’un arbre ressemblant à des pois dans un parc local l’été dernier, elle me semble résider ici. En lisant avec les lunettes de Havelet de Dostoïevski, il me semble pouvoir dire que mes mains et mes yeux étaient trop faibles pour saisir ce que je voyais – je ne pouvais ni maintenir les fruits dans une existence perpétuelle, ni voir jusqu’à leur cœur, pour comprendre et aimer la force qui les anime. Dostoïevski suggère que mon manque de contrôle constitue la simple réalité humaine, et que l’angoisse que j’en éprouve est une forme aveuglante et paralysante de honte, peut-être la grande maladie humaine. Il suggère que j’aurais pu continuer à regarder, que j’aurais pu continuer à ressentir mon impuissance. Cette sorte de force d’âme, face à mes limites, aurait pu me conduire à une posture de culpabilité ; elle aurait pu m’amener à comprendre ce que je suis et à l’accepter comme un bien. À partir de là, de grandes choses – ineffables puisque bien trop grandes – auraient pu se présenter à moi.
Dostoïevski en demande beaucoup ; on a l’impression d’un labeur dur, pénible, harassant. On dirait qu’il s’agit d’être secoué au plus profond de soi dans un petit parc sordide, au milieu de nounous et parents yuppies qui vérifient leurs téléphones en surveillant leurs petits aventuriers. Bref, sans doute plus que je ne pourrais en supporter. C’est aussi révélateur, cependant, de comment entrevoir la réalité – que cette réalité soit écrasante ou salvatrice, porteuse d’éternité ou de mort.