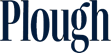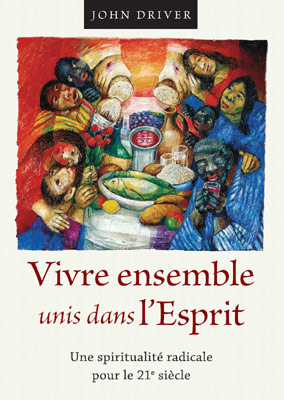Subtotal: $
Checkout
On éprouve une joie sans mélange à la lecture de cette lettre. Il me tardait d'y parvenir! Pas de reproches! Pas de ces « mais » qui vous attristent; rien qu'encouragements et conseils pour cette heureuse église, qui n'a rien perdu de son premier amour comme Éphèse, de sa fidélité comme Pergame, de sa pureté doctrinale et morale comme Thyatire, ni de sa vie spirituelle comme Sardes, et qui, seule avec Smyrne, reçoit l'entière approbation de Jésus-Christ!
Aussi, est-ce à qui sera Philadelphie! Pour les darbystes, par exemple, l'église de Philadelphie ce ne peut être que les darbystes; pour tel exégète que je soupçonne d'être morave, ce sont les frères moraves; j'ai des raisons pour croire que les grecs s'y reconnaissent sans peine, et, nous autres protestants, nous l'avons souvent revendiquée!
Je ne saurais, pour ma part, voir dans Philadelphie le type de tout le protestantisme, ni l'une seulement des dénominations qui s'y rattachent, et je pense qu'en dépit de toutes ses taches l'histoire de l'Église a compté assez d'époques de vie intense pour que ce bel état spirituel ait pu s'y reproduire plus souvent, et sous plus de formes ecclésiastiques, que ne le supposent ces interprétations exclusives.
Quatre caractères, très généraux, distinguent, en effet, l'église de Philadelphie. Sa faiblesse aux yeux des hommes: « Tu as une petite force! », faiblesse en nombre sans doute, faiblesse en influence sociale, en ressources financières, en science, en talents. Secondement, son attachement invincible à la parole du Christ, et la confession courageuse qu'elle fait de son nom. En troisième lieu, l'imitation de sa patience, car c'est, je pense, ainsi qu'il faut entendre ces mots : « Tu as gardé la parole, » ou le précepte, ou le mot d'ordre, « de ma patience. » Enfin, pour cette humble et rare fidélité, un amour particulier, une protection spéciale du Seigneur. Pensez à l'effet que dut produire ce mot: « je t'aime! » Pour s'entendre dire par Jésus : « je t'aime, » que ne donneraient pas ou ne souffriraient pas une église ou une âme chrétienne? Jésus aime, et d'un amour sans réserve, l'église de Philadelphie, et lui qui, seul, par un acte de sa puissance souveraine, peut ouvrir les cœurs ou les pays à l'Évangile, et bénir ou frapper de stérilité toute tentative d'évangélisation collective et individuelle, il a ouvert à cette petite église, soit dans le monde païen, soit, peut-être, surtout dans la colonie juive, « une porte, » c'est-à-dire un champ d'activité et de succès missionnaires, que rien ne pourra fermer.
I
Cela étant, ne trouvons-nous pas, dans l'histoire de l'Église, plus d'une époque ou plus d'une église répondant à ce portrait?
L'humble marchand de Lyon, que j'ai déjà rappelé, ce Pierre Valdo, pour qui l'on se sent pris d'une si vive sympathie, ne l'a-t-il pas reproduit au XIIe siècle? Quelle petite force que la sienne – seul contre la formidable église institutionnelle! Et quelle porte que celle qui lui fut ouverte, puisqu'on découvre tous les jours des preuves nouvelles de sa prodigieuse influence! Mais, aussi, quel attachement à cette Parole que, de ses deniers, il avait fait traduire! Quelle courageuse confession du nom de Christ, dans la persécution, quelle inaltérable patience!
Et plus tard, trois siècles après, dans sa belle période, dans son âge d'or, la réforme n'a-t-elle pas, à un haut degré, recommencé Philadelphie? Rappelez-vous Worms, le petit moine et l'imposante assemblée! Rappelez-vous les deux boulevards de la réformation; son principe formel : la Bible, et son principe matériel : le salut par la foi en Jésus-Christ. Rappelez-vous son admirable patience et sa miraculeuse propagation – dix à douze pays ouverts presque simultanément à son action régénératrice! En vain Satan essaya-t-il de refermer cette porte : en Allemagne par les intimidations papales, et, surtout, par les compromettantes sympathies des humanistes et des politiques, par le fanatisme de Carlstadt et la révolte des paysans; en Angleterre, par l'odieuse et cruelle parodie de Henri VIII; en France, par d'impitoyables persécutions où, dans un même martyre, se confondirent grands et petits, docteurs et simples fidèles, les Jean Leclerc et les de Berquin, les de Caturce, Pointet et Anne du Bourg. S'il réussit pour un temps en Italie, en faisant chasser ou tuer tous ces nobles témoins de l'Évangile qui s'appelaient : Curione, Paleario, Morata, Vermiglio, Occhino ou Vergerio, et en Espagne, où l'inquisition, arrivée presque trop tard, consuma dans ses atroces auto-da-fé l'œuvre immense des Valdez, Virvès, Valer, Juan Gil, Vargas et San Romano, il fut vaincu partout ailleurs.
Pour un homme qu'on tuait, dix se levaient aussitôt du sein du catholicisme, et le multipliaient en lui succédant. Partout surgissait comme une luxuriante végétation d'hommes savants ou intrépides. C'étaient, en Allemagne, un Mélanchthon, un Justus Jonas, un Bugenhagen, un Brenz ou un Lambert d'Avignon; à Strasbourg, Matthias Zell, Capito et Bucer; en Suisse, Zwingli, Oecolampade, Haller, Bullinger et Viret; ici même, Farel, Saunier, Froment, Jean Calvin et Théodore de Bèze; en France, outre tous ceux qu'elle nous a donnés, Le Fèvre d'Etaples, Olivétan, Coligny, Duplessis-Mornay; aux Pays-Bas, Marnix et Guy de Brès; en Angleterre, William Tyndale, Cranmer et Latimer; Patrick Hamilton, Willock, Wishard, John Knox en Ecosse; en Hongrie, Martin Cyriaci et Matthias Devay; en Suède, les deux Peterson; en Danemark, Reinhard et Tausen, et partout, sur leurs traces, comme une irruption, un débordement de la vie, une résurrection d'entre les morts, l'éclosion d'un printemps des esprits et des cœurs, et la première Pentecôte mille et mille fois répétée!
Ah! pourquoi la réforme n'a-t-elle pas persévéré partout dans cette voie de la patience? Pourquoi l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu, et l'étendard victorieux des premiers jours, le nom du Crucifié, ne lui ont-ils pas toujours suffi? Pourquoi n'a-t-elle pas persévéré à croire au triomphe de la vérité par la liberté? Pourquoi la politique s'en est-elle si vite emparée? Pourquoi les querelles sur la cène entre les réformateurs? Pourquoi le bûcher de Servet? Pourquoi les guerres de religion en France ? Hélas! pourquoi ? Pourquoi les hommes les meilleurs sont-ils encore des hommes – les plus supérieurs, par plus d'un préjugé, tributaires de leur époque, les plus sanctifiés, encore pécheurs, les plus expérimentés, encore faillibles? Pourquoi, en un mot, n'y en a-t-il qu'un seul qui ait eu le droit de dire de lui-même ce que nous lisons dans cette lettre : « le Saint, le Véritable? »
À lui seul donc, à ce seul Saint, à ce seul Véritable, notre absolue confiance, à lui seul tout notre cœur et notre esprit sans réserve! À lui seul, dans l'Église, hommages, gloire et louanges!
Lui seul en est le Chef, parce que seul il en est le Créateur et le vrai Réformateur!
Que personne ne se glorifie dans les hommes, mais que celui qui se glorifie se glorifie en lui!
II
Mais, si le Seigneur laisse commettre des fautes, il en répare les suites, et quand les hommes ont gâté son œuvre jusqu'à la compromettre, il intervient à temps pour en prévenir la perte!
C'est ce qu'il fit soit en Allemagne, soit en Angleterre, quand l'état de l'Église, devenu tel que nous l'avons dépeint à propos de Sardes, réclama impérieusement une réformation dans la réformation.
Mais, réformer des gens qui se croient tout réformés; réveiller un clergé qui veut absolument dormir, quelle tâche que celle-là! Qui pouvait l'accomplir? Alors, comme au 1er siècle, à Philadelphie, se vérifia cette loi du Royaume de Dieu que, tandis que pour les œuvres ordinaires Dieu ne craint pas d'employer quelquefois ce qui est grand aux yeux des hommes, pour les résultats exceptionnels, pour des succès immenses, il ne s'adresse qu'à ce qui leur parait petit!
Pour vous en convaincre, suivez-moi à Francfort – nous sommes en 1670, dans la chambre d'étude d'un jeune pasteur allemand. Des personnes de tout rang et de tout âge s'y entretiennent familièrement, non de quelque question irritante de polémique, mais d'expériences chrétiennes ou d'un fragment de la Parole de Dieu. Celui qui préside est un homme de trente-cinq ans à peine. Sa figure est douce et grave. Le matin même, – c'est un dimanche – il a prêché devant un auditoire immense et profondément attentif, car, depuis longtemps, on n'a pas eu en Allemagne un prédicateur aussi bien écouté. Et cependant cet homme est loin d'être un orateur. Sa diction est plutôt pesante, sa composition prolixe et sans grande originalité. Mais la simplicité toute biblique, la cordialité et l'accent de profonde conviction, qui caractérisent ses discours, contrastent si fort avec tout ce qu'on a entendu depuis un siècle, que le peuple, se sentant compris et aimé, accourt de toute part à cet enseignement.
Cependant cet homme n'achète pas la faveur au prix de la vérité. Il insiste, sans faiblir, sur la nécessité d'une nouvelle naissance, et sape tellement à la base les appuis trompeurs de la foi de tête que plus d'un auditeur, furieux, a résolu de ne plus venir l'entendre, tandis que les autres, arrachés à leurs illusions ou à leur torpeur morale, se préoccupent sérieusement de leur salut. Ce sont eux qui, spontanément réunis dans cette chambre, ou ailleurs dans la ville, se disent, comme autrefois les juifs : « Hommes frères, que ferons-nous? »
Qui est cet homme? Et qu'est-ce que ces réunions? Cet homme, né en Alsace et de bonne heure gagné à Jésus-Christ, cet homme, qu'on a vu à Genève, quelques années auparavant, dans les conventicules du pieux Labadie, c'est Spener, et cette réunion intime est la première de ces « réunions de piété, » de ces collegia pietatis qui vont sauver la réforme.
Spener est bien loin de s'en douter. Comme pour tous les vrais réformateurs, jamais l'idée ne lui est venue qu'il en pût être un! Il se croit, au contraire, si faible, il se sent naturellement si timide, qu'il a longtemps hésité à accepter son poste. Mais cet homme prie; cet homme « retient » la Bible, toute la Bible; il en aspire et en communique la sève vivifiante; cet homme aime ardemment le Seigneur; il vit dans son intimité; enfin il va déployer, en face des accusations les plus insultantes, d'autant plus pénibles qu'elles lui viendront d'une église tendrement aimée, une charité, une douceur, une « patience » de Christ, que ses ennemis eux-mêmes seront forcés d'admirer. Aussi Jésus l'aime-t-il; Jésus va lui donner un puissant auxiliaire en son ami Francke, et, à tous deux, « ouvrir » à tel point « la porte » des cœurs, que leurs prédications, leurs écrits et la propagation rapide de ces réunions intimes pénétreront l'Allemagne d'un esprit tout nouveau; et lorsque leur œuvre, elle aussi, s'altérera dans les mains de successeurs formalistes, à qui manquera leur esprit, elle sera reprise et continuée dans une autre œuvre issue en grande partie de la leur.
C'est, en effet, ce qui eut lieu!
En 1722, le 17 juin, dans la haute Lusace, au pied d'une colline appelée le Hutberg, un homme, entouré de quelques familles d'émigrés, enfonçait sa cognée dans un sapin en s'écriant : « Ici le passereau a trouvé sa demeure et l'hirondelle son nid! » Au près et au loin on ne voyait pas d'habitations; rien que forêts et marécages. Aujourd'hui, sur le même emplacement, dans une plaine bien cultivée, s'étale un joli petit bourg, qui est le foyer d'une immense activité. Vous avez nommé Herrnhüt! Quant à l'homme qui commençait sa cabane en citant le psaume 84, c'était Christian David; ces familles arrivaient de Moravie, chassées par la persécution; un homme généreux, le comte de Zinzendorf, les accueillait chez lui.
À quelque temps de là, en leur installant un pasteur, un prédicateur s'écria : « Dieu allumera sur ces collines une lumière qui luira sur tout le pays : j'en ai l'assurance par la foi! » Et, bien loin de la démentir, vous savez à quel point l'événement a dépassé cette prophétique parole. La lumière des moraves ne s'est pas bornée à éclairer l'Allemagne, elle est allée dissiper les ténèbres de nombreux pays païens.
Qu'était-ce, toutefois, que cette poignée de proscrits, sinon, pour le monde, un imperceptible grain de sénevé? N'étaient-ils pas une bien petite force? Mais, armés de la seule patience du Crucifié, débordant d'amour pour son nom et pour sa Parole, ils ont vu, eux aussi, s'ouvrir sur le continent, par une évangélisation infatigable, et, dans les pays païens, par le dévouement de leurs innombrables messagers, une porte que le temps n'a fait, dès lors, qu'agrandir. En 1732, leur premier missionnaire partait pour l'île de Saint-Thomas; l'année suivante, trois autres pour le Groenland; aujourd'hui, la Société en compte plus de trois cents, dans soixante-dix à quatre-vingts stations où sont groupés près de quatre-vingt mille païens amenés à la foi.
Quant à l'influence exercée par Zinzendorf et les moraves en diverses contrées de l'Europe, on la connaît généralement : Genève leur a plus d'une dette! Mais ce qu'on sait moins, c'est que l'Église chrétienne doit aux moraves, et, par conséquent, à Spener, qui fut, à bien des égards, le père spirituel en même temps que le parrain de Zinzendorf, l'homme dont Dieu s'est servi pour réveiller l'Angleterre au XVIIIe siècle.
III
Cet homme, c'est John Wesley.
Déjà, en 1735, pendant une terrible traversée, Wesley avait envié la paix de vingt-six frères moraves, calmes et heureux en présence de la mort. En Amérique, Spangenberg, qui fut le successeur de Zinzendorf, l'avait encore salutairement impressionné. Enfin, trois ans plus tard, de retour à Londres, toujours angoissé, comme autrefois Luther, il se rend dans une réunion de moraves. Il y entend décrire la paix que donne la foi; il sent son cœur se dilater; il sent qu'il se confie en Christ; pour la première fois, il croit à son propre pardon; alors, immédiatement, il se lève; il raconte ce qu'il éprouve : John Wesley est un homme nouveau! Peu de temps après, son frère. Charles et son ami Georges Whitefield le deviennent chacun comme lui; et ce sont ces trois jeunes hommes, ces trois étudiants d'Oxford qui vont reprendre, sans s'en douter, l'œuvre longtemps interrompue de la réformation.
Bien doués, ils le sont, il est vrai. Mais leur indomptable énergie et leur éloquence de feu c'est à leur foi qu'ils les devront. Faites-les « modérés, » comme on disait alors, et, du même coup, vous les ferez impuissants. Par eux-mêmes ils sont donc une force dérisoire contre le débordement de haine et de violence qui les attend. Ne verront-ils pas le clergé lui-même, le clergé protestant, se mettre souvent à la tête des bandes furibondes lancées sur eux pour les maltraiter? Mais rien ne les effraiera! Ils confesseront Jésus dans l'église établie, puis, quand celle-ci leur sera fermée, sur les places publiques, dans les mines, dans les champs et dans les parcs, où des foules de dix à quinze mille personnes, tantôt suspendues à leurs lèvres, tantôt folles de rage, entendront de leur bouche le message de salut. Whitefield convertira surtout les classes élevées, et réveillera les congrégations dissidentes. Les Wesley et leurs disciples auront, eux, pour mission spéciale, l'évangélisation des masses, les prisonniers, les mineurs, et le bas peuple. Semblables aux serviteurs de la parabole, ce sont eux, surtout, qui iront dans les carrefours et le long des haies. Wesley, qui tient de Zinzendorf l'organisation dont lui-même a emprunté l'idée à Spener, groupe, réunit, incorpore dans ses « classes » tous ceux que conquiert sa parole. Il improvise un ministère laïque itinérant, et si tout n'est pas également digne d'approbation dans les méthodes que son génie a inventées, il ne faut pas moins reconnaître qu'il a transformé l'Angleterre, et créé l'une des plus fortes et des plus actives églises de la chrétienté.
IV
Dans le même temps, que se passait-il en France? Deux siècles de persécutions rarement interrompues, en dernier lieu la révocation de l'édit de Nantes, qui avait jeté hors des frontières cinq cent mille huguenots, puis l'écrasement des camisards, paraissaient avoir extirpé si bien l'hérésie, que Louis XIV, nouveau Dioclétien, avait fait frapper une médaille destinée à rappeler toujours ce glorieux événement! De l'église réformée, plus rien! Plus de synodes, plus de cultes publics, plus d'organisation ni de pasteurs, mais d'autant plus de prétendus prophètes, d'aberrations et de sombre fanatisme! Il semblait que Satan eût vaincu en France, comme, jadis, en Espagne.
C'est alors qu'un jeune homme de dix-neuf ans, dans l'année même où Louis XIV se mourait à Versailles, honni de tout son peuple, entreprit, à lui seul, le relèvement de l'église réformée, comme jadis Néhémie, la reconstruction de Jérusalem. Avec une indomptable énergie, Antoine Court rassemble de petits groupes de fidèles, reprend les cultes publics, inaugure, en quelque sorte, l'église du désert, improvise, lui aussi, un ministère, convoque des embryons de synodes, rétablit l'antique discipline, réprime les abus des prophètes, crée, à Lausanne, une nouvelle pépinière de martyrs, voyage, prêche, se multiplie, communique partout son feu, inspire l'héroïsme, et, malgré la potence qui lui ravit ses collègues, malgré les galères, malgré la tour de Constance, malgré la froide férocité de Baville, réussit à tel point dans cette restauration du protestantisme, qu'après avoir eu, en 1715, dix à quinze personnes dans telle de ses réunions, en 1744 il en instruisait des milliers dans une seule !
Plus tard, il est vrai, le rationalisme et la mort spirituelle éteignirent beaucoup le feu de cette église, mais vous savez comment l'Esprit de Dieu l'a rallumé au commencement de notre siècle par le réveil général, dont les moraves et Robert Haldane ont été chez nous les instruments bénis. Le temps me manque pour vous parler, comme je le voudrais, de cette moderne église de Philadelphie, bien petite, elle aussi, aux yeux des hommes, mais à qui le Seigneur n'en a pas moins ouvert une porte dans le champ de l'évangélisation intérieure et des missions. (…)
V
Ah! quand on repasse ainsi l'histoire de ces divers réveils, depuis celui de Valdo jusqu'à ceux de notre siècle; quand on arrête son regard sur ces printemps spirituels qui, d'époque en époque, ont renouvelé l'Église, on se demande, avec honte, comment on a pu par moments concevoir quelque doute, ou même, seulement, n'avoir plus une certitude aussi ferme et aussi sereine, quoique toujours humble, quant à la victoire finale de Jésus-Christ? Quoi, le Chef de l'Église a toujours pu sauver son Église; aux époques les plus sombres et les plus tourmentées, il l'a tirée des états les plus désespérés ! D'un seul homme, plus d'une fois, oui d'un seul, il l'a fait renaître tout entière et plus florissante, et telle a été sa « puissance de résurrection, » dans son corps spirituel, qui est l'Église, que ni violences, ni ruses de ses ennemis, ni ce qui est bien pire, les erreurs, les divisions, les fautes, les crimes des chrétiens eux-mêmes, n'ont pu réussir à la détruire; après dix-neuf siècles de luttes, l'Église est aujourd'hui, sinon plus vivante, du moins plus étendue que jamais; sa vitalité se manifeste par des institutions et des œuvres innombrables, et l'on pourrait concevoir quelque inquiétude au sujet de son avenir, trembler pour elle, comme jadis Huza pour l'arche sainte, quand les bœufs avaient glissé. Les uns diraient : Nous sommes perdus si cette éventualité se réalise, si l'appui de l'État, si notre part du budget nous sont retirés. Et d'autres, nous, par exemple, membres d'une église libre : « Si nous perdons tel homme, si nous ne nous recrutons pas davantage, si nous ne pouvons disposer de nouvelles ressources, notre église est finie. » – Et que faites-vous donc de Christ? Philadelphie avait-elle tout cela? Ah, honte, mille fois honte à nous chrétiens évangéliques si, pour nos églises, nous avons d'autre souci que celui de les bien servir!
Je n'oublie pas, il est vrai, qu'il faut distinguer entre l'Église et les églises, et je ne prétends pas donner aux unes tout le bénéfice des promesses faites à l'autre. Les églises peuvent périr; l'Église seule est immortelle! Mais, à part de rares exceptions (par exemple, au XVIe siècle, en Espagne, les congrégations évangéliques), je ne sache pas que jamais église soit morte autrement que par la faute de ses membres, et que la violence de ses ennemis ou la pénurie de ses ressources aient suffi à la détruire, quand un vice d'organisation et, surtout, le déclin de la vie n'y ont pas aidé!
Si donc nous sentions nos églises menacées, il faudrait énergiquement chercher à supprimer le mal, quel qu'il fût, pour pouvoir remettre à Dieu le reste. Il faut, en tout cas, rappeler à nos églises qu'elles ne sauraient vivre de leur gloire passée, et que, si elles ont reçu de leurs fondateurs une « couronne » de vérité et de piété vivante, elles ont à la « tenir ferme » pour pouvoir la conserver.
Mais prendre en gémissant notre parti de leurs misères ou de leur langueur, comme d'un mal inévitable et incurable; mais assister, mornes et inertes, à leur décadence si jamais elles en venaient là; mais croupir dans le découragement – ah, pour cela, jamais, non jamais! Le découragement, c'est la défaite avant la bataille! Le découragement, c'est la carie de l'âme; le découragement, c'est la négation pratique de Dieu ! Humbles, pour nos églises, nous devons l'être toujours; humiliés, souvent; découragés, jamais! Et c'est à elles, non moins qu'à l'Église tout entière, que j'appliquerai ce beau mot du pasteur Staudt de Kornthal: « Pour l'Église, il faut non pas trembler, mais travailler!
Travailler avec bonheur; travailler avec courage, sans fièvre ni défaillance; travailler, sans autre moyen d'influence que la patience, la Parole et le glorieux nom de Jésus-Christ!
Il est beau de travailler ainsi, et pour un tel maître! Ne nous lèverons-nous pas tous pour cette œuvre? Une telle cause ne ferait-elle pas battre notre cœur?
Jeunes gens, hommes faits, le Seigneur vous appelle, et si vous avez besoin de lui, lui veut bien aussi avoir besoin de vous! Vous lui êtes nécessaires pour sauver les âmes, après qu'il aura sauvé la vôtre ! Lui refuseriez-vous votre concours? Si vous tenez pour devoir et privilège d'être les appuis de votre patrie, n'ambitionnerez-vous pas, plus encore, de devenir les colonnes d'un temple qui ne s'écroulera jamais?
Le temps se hâte; les événements se précipitent; notre monde est, peut-être, à la veille de grandes épreuves, telles que celles dont parlait cette lettre, et si Jésus disait déjà à Philadelphie: « je viens bientôt, » combien plus aujourd'hui ne nous le dirait-il pas ?
Nous trouvera-t-il veillant et travaillant? Sommes-nous fidèles à entrer dans, les portes qu'il nous ouvre? Ici, dans ces populations nouvelles, ignorantes, mais accessibles peut-être, et qui nous condamneront un jour si nous les négligeons aujourd'hui? Ah, c'est dans ce champ que notre église retrempera ses forces, en sortant salutairement d'elle-même! Il faut qu'elle médite cette parole d'un frère morave « Il y a longtemps que notre église se serait pétrifiée dans ses vieilles formes, si l'œuvre des missions ne ranimait sa vie incessamment. »
Et en France, dans cette France que le sang des martyrs a, deux siècles durant, abondamment ensemencée, serions-nous prêts à envoyer de l'argent et des hommes si, tout à coup, une porte plus vaste s'y ouvrait à l'évangélisation, si ces adhésions d'hommes de bonne foi, sinon tous de foi, n'étaient que les prémices d'une moisson magnifique?
Il est temps, il est temps de sortir de notre apathie; il est temps de vivre, il est temps de nous dévouer, corps et biens. Il est temps, aussi, que les chrétiens se groupent davantage, pour former, au-dessus de leurs églises, un corps qui s'appellera, aussi, Philadelphie.
Philadelphie, ce nom a-t-il été providentiellement donné à cette ville et à cette église? Je l'ignore; mais il est trop beau pour que je ne vous le propose pas!
Philadelphie, c'est « l'amour des frères! » Philadelphie, c'est, par conséquent, au-dessus de tout ce qui sépare, l'amour du Christ qui réunit! Philadelphie, ça été l'esprit de la primitive Église, trop peu celui de la réforme, mais beaucoup plus, toujours plus celui des réveils qui ont suivi... Philadelphie, tel doit être toujours plus notre mot d'ordre! Dans ce sens-là, aussi, soyons des chrétiens de Philadelphie! Sans faire tort à nos principes, tendons à tous nos frères en Christ une main vraiment fraternelle, une main d'association, travaillons avec eux; prions avec eux; aimons avec eux, en attendant que nous soyons, un jour, dans la céleste Philadelphie avec eux.