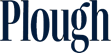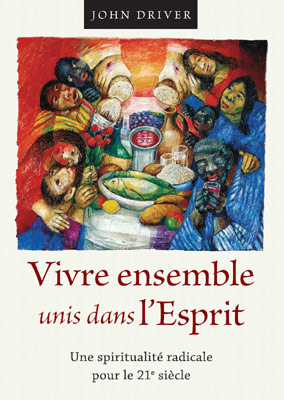Subtotal: $
Checkout
Évocation de la région du Weald
Les consolations d'un endroit très cultivé
par Adam Nicolson
mercredi, le 16 juin 2021
Autres langues: English
L’article suivant:
Si vous connaissiez le Weald du Sussex uniquement en regardant où il se trouve sur une carte de l’Angleterre, vous ne devineriez jamais ce que c’est. Coincé entre la banlieue de Londres au nord et la périphérie des villes côtières au sud, intensivement traversé par routes nationales et voies ferrées, on y trouve quelques villes de relative importance, outre un aéroport international géant : que peut-on donc y voir d’autre qu’une banlieue post-industrielle, un lieu dont les significations profondes sont cachées sous une surface frénétique, défigurée, moderne et utilitaire ?
Même en la traversant en voiture par les départementales, on passe à chaque tournant devant des panneaux de signalisation, et impossible de ressentir ce qu’elle est. Non, il n’y a qu’un seul moyen : à pied, loin du bruit de la circulation. Alors quiétude et sens du passé ont le loisir de s’échapper du sol et vous accompagner.
Choisissez l’un des nombreux chemins creux cachés qui sillonnent ce pays humide et arboré. N’importe quelle carte à grande échelle vous les suggérera, mais choisissez-en un qui s’enfonce dans une vallée peu touristique. Immédiatement, l’endroit se refermera sur vous. Souvent, les murs d’argile du sentier sont tapissés de mousse ; au printemps éclosent primevères et anémones des bois. Il vous conduit à travers jacinthes des bois et ciguës, jusqu’à un petit ruisseau qui s’enfonce sous un toit de ramures au travers des terres d’argile et de grès de cette région.

Gill Bustamante, Épiphanie, peinture empâtée sur toile, 2018. Œuvre d'art de Gill Bustamante. Utilisé avec permission..
Une grande partie de cette plaine profonde, humide et boisée du Weald est désormais presque abandonnée. Les taillis de noisetiers, les charmes et les frênes sont négligés depuis des décennies, de sorte que chaque tige sortie de la souche originelle est devenue un arbre forestier adulte, qu’on trouve par endroit abattu par les tempêtes hivernales, couchés à l’horizontale parmi ses voisins.
Ces forêts– c’est ainsi qu’est boisée la plus grande partie de l’Angleterre – deviennent de plus en plus sombres à mesure que l’été se fait sentir et c’est l’agréable fraîcheur dissimulée de ces havres d’ombre en plein été que Rudyard Kipling aimait tant retrouver dans la vallée creusée par la rivière Dudwell, près de Burwash, où il vivait :
Même sur l’eau ombragée, l’air était chaud et lourd d’odeurs léthargiques, alors qu’à l’extérieur, le soleil se glissait à travers les trous des ramures pour brûler le pâturage aussi intensément qu’un feu...
Les arbres refermés l’un sur l'autre au-dessus de sa tête formaient de longs tunnels à travers lesquels le soleil dessinait des pavés de lumière. Au fond des tunnels se trouvaient des bancs de sable et de gravier, de vieilles racines et des troncs couverts de mousse ou peints en rouge par l’eau ferrugineuse ; des digitales poussaient leurs pâles et maigres tiges vers la lumière ; par contre, des touffes de fougères et des fleurs assoiffées et timides ne pouvaient vivre loin de l’humidité et de l’ombre.
Kipling est venu s’installer ici après sa vie aventureuse en Inde, en Amérique et en Afrique du Sud. Il recherchait un endroit où pouvoir échanger de vastes étendues impériales. Pour un cadre plus étroit, plus profond et plus ancien, troquant ainsi des horizons gigantesques contre le puits profond de l’ancienneté. Il n’aurait pas pu mieux choisir.
Je ne connais pas de paysage aussi riche en indices du passé. C’est peut-être parce que la modernité en a abandonné une grande partie, permettant aux bois de retrouver une sauvagerie qu’ils n’ont probablement pas connue depuis l’obscur Moyen-Âge. Les vieilles structures faites à la main – non seulement les allées, mais aussi les bosquets qui autrefois protégeaient les jeunes arbres des cerfs, les taillis eux-mêmes, l’imbrication des champs et des bois, les étangs isolés et abandonnés, autrefois bloqués par les barrages alimentant les usines sidérurgiques, ou encore les fosses où les fermiers extrayaient la marne calcaire qui venait adoucir leurs sols acides.

Gill Bustamante, Célébration, huile sur toile, 2020
Je suis venu vivre ici pour la première fois il y a trente ans, fuyant Londres et cherchant un refuge, un endroit où ma femme, Sarah, et moi pourrions faire notre vie. Nous avons trouvé une petite ferme laitière délabrée, dans un paysage plutôt rude, à la limite de Brightling et Burwash. On l’appelait Perch Hill, ce qui signifie colline de bâtons ou de poteaux, car les sols argileux des champs ne permettaient de cultiver guère davantage que des arbres en taillis. Ce fut la meilleure décision de ma vie : la pauvreté de la ferme avait préservé la plupart de ses formes essentielles, ses bois et ses champs. Il ne nous restait plus qu’à enlever béton et tôle ondulée, replacer quelques haies, et planter quelques arbres, pour trouver autour de nous un lieu riche et précieux.
C’est en grande partie un pays désert. La mécanisation et la domination des marchés lointains rendent inutile de son occupation comme à l’époque où ce paysage a été créé. C’était lors de la grande poussée démographique des XIIe et XIIIe siècles, lorsque le temps était plus doux et sans gelées en mai et où les gens d’ici s’aventuraient même dans les terres marginales que le Weald a toujours représentées.

Linoprints par Carolyn Cox. Utilisé avec permission.
YIl faudrait se rendre dans un pays tout aussi pauvre, peu développé et encore artisanal, comme les vallées de la Transylvanie orientale, pour trouver encore aujourd’hui une atmosphère qui rappelle de près ou de loin le Weald historique. J’avais lu des articles sur les merveilleuses prairies de Transylvanie, épargnées par les herbicides ou l’excès d’engrais azoté. Un printemps, je suis allé avec Sarah y chercher des fleurs. Je ne m’attendais vraiment pas à trouver un pays habité de façons qui ont soudain fait diversement écho avec ce que fut sans doute autrefois la vie dans le Sussex Weald. Les paysages sont étrangement les mêmes – des fermes en bois, des champs bocagers, des prairies cultivées où pait le bétail, des forêts bien exploitées – mais ce qui surprend le plus le touriste du Sussex venu en Transylvanie, c’est l’activité qui y règne en tous lieux : au début du printemps, quand la neige a disparu, partout autour de vous apparaissent des gens en train de labourer, biner, couper le bois mort des arbres en têtard... niveler les taupinières, couper les tiges de haricots, planter les haricots, ratisser les vieilles feuilles, sortir le fumier. Les femmes marchent en tirant des chevaux par la bride, et les hommes suivent derrière, agrippés à la charrue. Les pâturages sont sillonnés de dragues tirées par des bœufs, les terres labourées sont défoncées par des herses tirées par des chevaux. Les dernières charrettes de foin de l’été précédent, restées empilées tout l’hiver dans les prairies, sont rapportées dans les étables avant que le bétail ne soit mis au pâturage au printemps. Le seul bruit sur la route est le grincement huilé des essieux des charrettes qui passent. Il n’y a pas de journée plus merveilleuse que celle où l’on charge le foin sur l’un de ces chariots, où on le ramène à l’étable et d’où on le fourche pour l’abriter pendant l'été.
Quand on l’a vu, senti et entendu, ce monde très peuplé commence à donner un sens au Wealden et à son réseau de ruelles, de bois et d’étroites brèches, ces bandes d’arbres, souvent coupés en taillis, qui divisent les champs. Aucune machine n’a concouru à le façonner. Tous les outils étaient des outils à main, tout le travail était fait à la main. Seuls les moulins – comme l’ancienne structure grinçante de Bateman’s qui moud encore le maïs grâce à la force de la Dudwell, qui y est acheminée par de longs canaux peu profonds – n’étaient pas actionnés par la force musculaire, animale ou humaine.

L’ingrédient-clé était le travail manuel. La beauté du Weald tient à ce que ce pays a été fabriqué à la main, et il porte encore dans ses os le souvenir d’un lieu de grande pauvreté et de dur labeur. Essayez donc de creuser un trou pour planter un poteau dans l’argile, ou même d’enterrer un animal de compagnie ou un agneau mort au coin de la maison ou dans un champ, et vous constaterez rapidement à quel point la terre est intraitable : les chemins encaissés des Wealden étaient pour la plupart impraticables tout l’hiver, ou il aurait fallu un attelage de bœufs pour tirer un chariot à travers leurs mottes, et il suffit à peine d’un jour de soleil pour que cette terre collante se transforme en un béton tout aussi intraitable. Quiconque aurait pu choisir de cultiver ailleurs n’aurait jamais délibérément choisi de telles difficultés.
Tout le monde était soumis à la tyrannie du travail. Une ancienne paroissienne de Burwash dans les années 1850 décrit ainsi sa vie de jeune fille à la fin du dix-huitième siècle :
Quand j’avais seize ans, on m’emmenait, comme une vache, au marché, où les fermiers en quête d’une servante venaient en choisir une. Dans la ferme où je suis allée travailler à Wadhurst, je barattais deux fois par semaine, faisais du fromage deux fois par semaine, et je brassais la bière deux fois par semaine, outre la lessive et la préparation du pain ; j’avais aussi six vaches à traire chaque soir et matin, et parfois une douzaine de cochons à nourrir. Quatre hommes vivaient dans la maison, et j’avais tout le ménage et la cuisine à faire – le chou, les pois et le porc pour leurs dîners, sans compter les lits à faire.
Elle était payée un shilling et six pence par semaine et commençait parfois à travailler à quatre heures du matin pour finir à minuit.
La difficulté et la nécessité d’un travail intense et éprouvant pour le corps ont créé ce paysage d’intimités liées les unes aux autres, une partie du monde truffée de vie humaine : les châtaigniers plantés à côté des charmes, pour leur solidité et capacité à faire le meilleur charbon de bois ; le frêne pour la légèreté indispensable aux manches des râteaux ou des faux ; le chêne pour sa robustesse éternelle servait à fabriquer les maisons à toit de chaume et les bûchers qui composaient chaque ferme. Historiquement, les champs étaient minuscules, souvent moins d’un hectare. Les fermes étaient aussi petites, souvent pas plus de 8 hectares, 12 maximum, avec quelques vaches, quelques cochons et des poulets. Les bœufs étaient les animaux de trait les plus prisés, mais il s’agissait d’une agriculture à l’échelle du jardinage.
Quelques hectares étaient ensemencés de blé ou d’avoine, mais les deux grandes productions vivrières du Weald étaient le bois et le foin. Tout comme en Transylvanie aujourd’hui, ce monde avait besoin de bois pour ses ouvrages– non seulement les bâtiments, mais aussi les clôtures autour des jardins et des étables, les râteliers à foin, les poulaillers, les porcheries – et comptait sur l’herbe pour se nourrir. C’était un monde construit sur le foin, ce transfert régulier de nutriments des prairies d’été aux étables d’hiver, sans lequel tout le système se serait effondré. Si vous trouvez encore une ferme qui conserve ses anciens bâtiments, vous aurez en fait devant vous la cohabitation imbriquée d’êtres humains, de bétail et d’herbe.

Gill Bustamante, Coquelicots dans une prairie du Sussex, huile sur toile, 2014
C’est peut-être pour cela que, même avec les machines modernes, la récolte du foin, en juillet, reste le lien le plus profond avec ce vieux monde. « La fenaison », comme on l’appelle, sur le même principe que le « bûcheronnage » ou l’« agnelage », est le point culminant de l’année, le point autour duquel tourne tout le reste. C’est le moment où un champ d’herbe livre ses richesses, d’abord lisses et brillantes, comme des mèches de cheveux sur le sol d’un salon de coiffure, puis mis en balles et ramenées à la maison comme des lingots offerts par l’été généreux. Vous n’entendrez jamais un fermier du Sussex s’extasier devant ce moment de fenaison, mais il y a quelque chose de magique quand le foin a été bien fait. « Regarde ça », me disait toujours Fred Groombridge, un vieux fermier de Brightling, quand il essayait de me vendre une ou deux balles de son foin. « Mets ton nez dedans, Adam. Tu sens le soleil de l’été là-dedans, hein ? » Fred me regardait toujours avec un œil fermé. « Pourquoi donc ? » ai-je demandé à un ami. « Parce qu’il pense avec l’autre ».
C’est une histoire de localité intense et d’horizons courts, ce domaine étant essentiellement distinct de celui-là, et une belle et riche langue locale dérivée des Saxons, qui ont donné leur nom au Sussex pour le décrire : se salir dans le Weald, c’est se faire tremper ; résoudre un problème implique de le remuer un peu ; les brindilles qui tombent d’une haie coupée sont les brishings ; un poteau de clôture se dit spile ; une faucille, swop. Je pense que la plupart de ces mots sont en voie d’extinction aujourd’hui mais, il y a vingt-cinq ans, lorsque je faisais les foins avec Fred et ses amis, c’était le langage qu’ils utilisaient, aussi vieux que les bois, plus vieux que les haies.

Kipling l’a appelé « The wooded, dim blue goodness of the Weald » (La bonté bleue et boisée du Weald), phrase mémorable, mais ce sentiment romantique d’un monde perdu vu à distance est probablement plus un reflet de l’état d’esprit de Kipling – lorsqu’il s’est retiré du monde à Bateman’s – que ce qu’aurait été cet endroit lorsqu’il était pleinement vivant. Heureusement, David et Barbara Martin, les grands historiens du localisme dans le Weald, ont déniché un compte-rendu de tous ceux qui vivaient et travaillaient à Ninfield en 1702, ménage par ménage, profession par profession, famille par famille. Il s’agit d’un relevé d’impôt annoté, et ce qu’il révèle c’est un monde minuscule, complexe et presque autosuffisant de fermiers, tous à temps partiel, occupés aussi à d’autres activités venant en appoint des finances familiales. Au bas de l’échelle sociale se trouvent les travailleurs sans terre : le tondeur de moutons, le « collier », c’est-à-dire celui qui fait du charbon de bois, quelques charpentiers et deux bouchers. Beaucoup de ces pauvres hommes n’avaient qu’un petit jardin potager et plusieurs d’entre eux vivaient en totale autarcie. Néanmoins, en 1702, Ninfield avait son propre cordonnier, gantier, tisserand, tanneur, et même deux tailleurs. Il s’agissait d’un lieu où l’on était non seulement nourri et logé par sa propre terre, mais aussi vêtu et chaussé par elle.
En s’élevant dans l’échelle sociale, au-dessus des couches inférieures dans lesquelles la plupart des fermes ne dépassaient pas 6 hectares et certaines 2 à peine, on trouvait les artisans qualifiés – un charron, un meunier, un charpentier et un « sanglier » – le vétérinaire. Enfin, un groupe d’hommes de plus grande envergure, possédant chacun plus de 20 hectares, et diversement classés comme gentlemen et yeomen, dont le plus riche exploitait plus de 160 hectares. Trois domestiques vivaient dans sa belle maison, Queen Anne, à Lower Standard Hill (aujourd’hui connue sous le nom de Luxford House) mais, comme presque tout le monde dans le village, il n’avait pas d’enfants adultes vivant avec lui. C’était une vie difficile à gagner, même pour les personnes relativement riches, et les enfants adultes devaient être poussés dehors pour aller tenter leur chance dans le monde.
Ce monde a changé, de toute évidence. Même au cours des trente années où je l’ai connu, le Weald a perdu une grande partie de sa spécificité locale : ses modes de vie, de parler et de penser, de gagner sa vie, les liens avec les bourses locales (dont la plupart ont disparu) et les abattoirs locaux (même sort) se sont tous généralisés, sont devenus moins distincts, moins Wealdéens.
Ces changements se répercutent sur l’économie. Sur près de 50 000 emplois dans le Sussex, à peine 600 sont aujourd’hui liés à la terre. Ce chiffre a diminué de 400 au cours des dix dernières années. Le revenu moyen d’une exploitation herbagère de plaine en Angleterre est de 9 400 £ par an (plus la subvention, dont l’avenir est incertain), ce qui suffit à expliquer pourquoi les jeunes hommes et femmes ne se lancent pas dans l’agriculture. Aucun d’entre nous n’aime la perspective de baratter deux fois par semaine, faire du fromage deux fois par semaine, brasser deux fois par semaine, faire les foins à la main, bucheronner le charme pour se chauffer l’hiver, nourrir les cochons ou traire les vaches matin et soir. Il serait ridicule de se languir de la pauvreté matérielle du passé. Même en Transylvanie, les mêmes processus de délocalisation sont en cours.
Et alors, que nous reste-t-il ? Seulement un paysage plein de coins cachés et la mémoire persistante de la vie qui l’a créé, les prairies d’orchidées qui ont survécu – par chance ou parce qu’un agriculteur a valorisé une fleur. Les bois, comme l’a écrit Kipling, qui « savent tout et ne disent rien » : les consolations d’un lieu qu’il faut parcourir pour le connaître, pour rencontrer ses souvenirs à travers la plante des pieds.