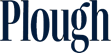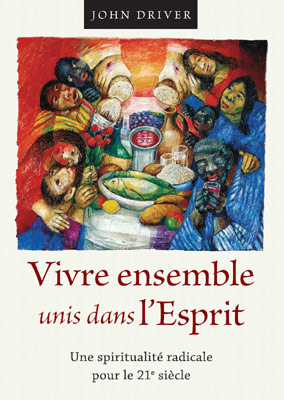Subtotal: $
Checkout
L’article suivant:
Nouveau venu en Allemagne, je n’étais pas préparé à endosser l’uniforme de la guilde des couvreurs. Plusieurs de mes compagnons de travail le portaient, malgré le soleil de plomb d'août : chemise blanche, gilet à huit boutons, pantalons en velours côtelé noir avec poches de menuisier et fermetures éclair doubles bien en vue. « Les gens normaux portent ça ? », me suis-je demandé en transportant des piles de carreaux de céramique jusqu’à l'endroit où un pignon était en cours de restauration. Même en T-shirt et jeans, c’était déjà un dur labeur : cadences rapides et pas le temps de se raconter des blagues.
C’était en 2004, et ma femme et moi, nouvellement mariés, étions arrivés de New York à Dresde, quelques jours auparavant. Nous vivions chez un ami qui rénovait sa villa centenaire, et j’ai proposé d’aider les couvreurs pendant l’été. D’après ce que j’avais vu des entreprises de toiture aux États-Unis, je m’attendais à trouver une équipe de coupeurs de coins, avec des employés mal formés travaillant pour un faible salaire. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à travailler avec une entreprise familiale – avec maîtres, compagnons et apprentis –, qui affichaient tous ouvertement leur pitié de toute personne n’étant pas couvreur. Même pour un non-couvreur, c'était convaincant.
Non pas que les relations de travail dans cette équipe aient été toutes empreintes d'une joyeuse camaraderie, ou que le salaire était particulièrement bon. Les compagnons de la région, apprendrais-je, ne gagnaient généralement que sept à huit euros de l'heure, même avant impôts. Mais les couvreurs étaient fiers : d’un travail acharné, d'un travail accompli selon des normes exigeantes, d'un métier aux traditions et à la dignité bien établies. Pour ces hommes, l'honneur revenait à ceux qui transpirent sur les échafaudages, et non aux professionnels en col blanc dont ils construisaient ou réparaient les maisons. Sur le chantier, la hiérarchie capitaliste s'est temporairement renversée : l'artisan, et non le client, était roi. Il faut être un VIP, après tout, pour avoir le culot de porter des pantalons à double fermeture éclair.

L’uniforme noir de la guilde des menuisiers allemands, dont les couvreurs, remonte au XIXe siècle..
Photographie de mewa.cz
Ces couvreurs me sont revenus à l'esprit alors que je lisais Bullshit Jobs, livre récent de David Graeber, professeur d’anthropologie à la London School of Economics. Selon M. Graeber, une grande partie des emplois d’aujourd'hui exigent d’effectuer des tâches que les employés eux-mêmes jugent inutiles. Il rapporte que dans un sondage YouGov de 2015, 37 % des Britanniques ont déclaré que leur emploi n’apportait pas au monde une contribution significative ; dans une autre enquête, 40 % des travailleurs néerlandais estimaient également que leur emploi ne leur offrait pas de bonnes raisons d’exister. Quels sont ces emplois socialement inutiles ? La plupart d’entre eux, affirme M. Graeber, ont trait à des fonctions administratives, de gestion, dans un bureau, le secteur des services et de la vente, télémarketing entre autres – des secteurs du marché du travail qui, à eux tous, sont passés du quart de l’emploi total en 1910 aux trois quarts en 2000. Au moyen de douzaines d’entretiens approfondis, Graeber soutient que les travailleurs qui jugent leur emploi sans valeur ont probablement raison.
Que la thèse globale de Graeber se vérifie ou non, les personnes interviewées expriment avec force une aspiration grandissante dans le monde développé : le désir de faire un travail qui ait du sens est une finalité. Selon une étude réalisée en 2018 par le Harvard Business Review auprès des travailleurs américains, neuf répondants sur dix ont déclaré être prêts à renoncer à une partie de leur salaire pour faire un travail porteur de davantage de sens ; seulement un sur vingt considère son emploi comme aussi impératif que possible. Les auteurs de l’étude considèrent ce résultat comme une occasion unique pour les managers : si vous trouvez le moyen de donner aux employés l’impression que leur travail a un sens – en mettant par exemple sur pied des projets socialement responsables et des concours de développement durable ! – ils travailleront volontiers plus, pour moins cher.
Marx a décrit l'aliénation du prolétariat industriel par rapport à leur travail ; cette nouvelle aliénation touche aussi les cols blancs. Claudio Oliver, agriculteur brésilien à Curitiba, m’a raconté que des dizaines de professionnels, la plupart dans la vingtaine, viennent chaque mois visiter le jardin urbain et la boulangerie qu’il a contribué à créer. Quel est le profil des personnes qui viennent à lui ? « C’est typiquement un jeune homme ou une jeune femme qui se rend un jour à son travail de bureau, en open-space, et regarde par la fenêtre travailler l’équipe d'aménagement paysager. Il se dit : « Ça alors ! Je donnerais cher pour être le type qui conduit la tondeuse à gazon au lieu de faire mon boulot ». Beaucoup de visiteurs finissent par prendre un congé sabbatique de quelques semaines voire de quelques mois, pour apprendre à cultiver les légumes, élever des chèvres et faire dorer du pain au levain ; plusieurs sont devenus membres permanents de la communauté qui gère la ferme.
La vocation, l’ « appel » est la réponse que donne le christianisme protestant lorsqu’on lui demande ce qui donne un sens à notre travail. La vocation résume l’une des idées marquantes de la Réforme : chaque personne est appelée par Dieu à servir le bien commun dans son activité particulière. Aujourd’hui, c’est un thème fondamental pour les auteurs chrétiens, pasteurs de jeunes, coachs de vie et conférenciers : « Tout le monde a reçu une vocation de la part de Dieu. Quelle est la vôtre ? » Votre vocation, évidemment, c’est pratiquement n’importe quel métier : infirmière, guide en milieu sauvage, calligraphe, missionnaire, activiste, investisseur en capital risque, politicien, que sais-je …
Comment connaître votre propre vocation ? « Un appel, c’est simplement une sorte de force d’attraction sentie dans nos cœurs et exercée par Dieu envers une activité particulière », conseille le magazine Relevant. « Suivez votre passion », recommande la publication en ligne Theology of Work, prenant ainsi à son compte une devise séculière. Voici une façon plus poétique de dire la même chose, celle du théologien presbytérien Frederick Buechner : Une vocation, écrit-il dans son livre Wishful Thinking: A Theological ABC, publié en 1973. C'est « le lieu où se rencontrent votre joie profonde et un besoin profond du monde ».
C’est aussi palpitant que tomber amoureux. Vocation : le coup au cœur que vous ressentez à la foire des carrières universitaires, en passant devant ce stand particulier – et tout cela pour la plus grande gloire de Dieu !
Mais ces concepts de si haute volée laissent de côté la plus nombreuse partie de l'humanité. Ce n'est pas avec une joie profonde que les gens se font engager pour travailler dans un motel, un supermarché ou un centre d'appels, et encore moins dans des ateliers clandestins ou comme travailleurs agricoles migrants. Pourtant, chaque jour, des millions de personnes sont affectées à de tels emplois. Suivre sa passion n’est pas non plus un choix accessible à ceux qui sont empêchés de travailler en raison d'un handicap, d’une maladie mentale ou d’un traumatisme. La vocation est-elle donc réservée aux seules personnes compétentes, instruites et talentueuses ?
Les travailleurs qui croient que leur travail ne vaut rien ont probablement raison.
Pas selon la conception originale de la Réforme, qui était à la fois plus profonde et plus réaliste que beaucoup de discours contemporains sur la vocation. Au XVIe siècle, Martin Luther commença à revisiter un verset de l'apôtre Paul : « Que chacun demeure dans la vocation où il a été appelé » (1 Co 7, 20). Luther s’empara du mot « appel » et lui donna un sens plus large que ne lui avait jamais donné l'Église médiévale, qui mettait l’accent sur les appels spéciaux des prêtres et des religieux monastiques. L’appel d'une personne, disait-il, c'est simplement de faire sa vocation de ce qu'il fait à n'importe quelle étape de sa vie ; c'est sa vocation tout simplement parce que c'est l'endroit où Dieu, par sa providence, l'appelle à aimer son prochain. Bricoleur, tailleur, soldat, marin sont toutes des vocations ordonnées par Dieu, et donc d'égale valeur. Aussi subalterne que soit l’emploi, c’est une vocation sacrée par laquelle Dieu agit dans le monde. « Dieu trait les vaches au moyen de la vocation des ouvrières de la laiterie », comme le dit Luther.
La vision de la vocation défendue par Luther s'avérerait une puissance libératrice, donnant une dignité nouvelle aux travaux des paysans et des artisans ordinaires. Affinée par Calvin, elle remodèlerait une grande partie de l’Europe ; en fait, comme l’a affirmé Max Weber, l’idéal protestant de vocation, qui met l’accent sur une forte éthique du travail et un dévouement ascétique à la discipline de son métier, a contribué à l’essor du capitalisme.
C’est dans ce contexte que des écoles « professionnelles » existent aujourd'hui. On y enseigne la plomberie ou la soudure, et non les pratiques spirituelles. C’est la raison pour laquelle les Constitutions de plusieurs nations garantissent la liberté de suivre sa vocation comme un facteur essentiel à la dignité humaine. Et cela explique probablement – au-delà des vicissitudes de l’histoire – la fierté des couvreurs allemands en velours côtelé avec lesquels j’ai travaillé à Dresde. Comme Luther – qui a longtemps fait de cette région d’Allemagne sa patrie – aurait-il pu le dire, Dieu construit les toits grâce à la vocation des couvreurs.
Quelles que soient les vertus uelles que soient les vertus de l’idéal, le protestant de vocation, cependant, souffre d’un grave défaut : s’il se prétend conforme à l’enseignement du Nouveau Testament, c’est à tort. Luther illustre très clairement ce défaut en poussant le raisonnement à l’extrême. À ses yeux, tout travail – et pas seulement l’agriculture ou l’artisanat – exprime la volonté de Dieu ; il y a beaucoup de vocations possibles. Par exemple : « Si vous constatez une pénurie de bourreaux... et que vous trouvez que vous êtes qualifié, vous avez le devoir d’offrir vos services. » Il ajoute : « Car la main qui manie cette épée et tue avec elle n’est pas celle de l’homme, mais celle de Dieu ; et ce n’est pas l’homme, mais Dieu, qui pend, torture, décapite, tue et combat. Ce sont les œuvres et jugements de Dieu. »
Aucun bourreau n’est donc laissé pour compte par cette théologie de la vocation. Pourtant, il est difficile d’imaginer quoi que ce soit de plus contraire à l’esprit du Jésus des Quatre Évangiles ou, d'ailleurs, du reste du Nouveau Testament.
Quand les écrivains du Nouveau Testament utilisent les mots comme vocation ou appel, ils ne se réfèrent jamais au travail, encore moins à un métier ou une profession en particulier. Comme Will Willimon l’explique (page 14), le Nouveau Testament ne connaît qu’une seule forme de vocation : celle de disciple. Et le discipulat est bien plus susceptible de signifier quitter père et mère, sa maison et sa terre, que d’embrasser son identité de pêcheur ou de percepteur d’impôts. Elle exige de sacrifier ce que nous désirons naturellement. « Quand le Christ appelle un homme, dit Bonhoeffer, il lui ordonne de venir mourir. »
La plupart d'entre nous préféreriaient suivre Luther en nous contentant d’un simple apologie du statu quo.
Certes, cette façon de parler de vocation n’est guère tendance. La plupart d’entre nous préféreraient suivre Luther en nous contentant d’une apologie du statu quo, malgré toutes les contradictions qui pourraient en découler. Quand d’autres ressentent le tourment d’un vide flagrant dans leur vie – quand ils sentent l’aliénation qu’entraine le travail et la vie au sein d'un ordre social injuste – nous voudrions bien appliquer sur leurs blessures le baume apaisant de la vie chrétienne, en leur assurant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles !
Or, c’est précisément le statu quo que le Christ est venu abolir : « Voici, je fais toutes choses nouvelles » (Ap 21:5). En lieu et place, il a apporté la seule véritable vocation, l’appel à une vie ordinaire renouvelée, entièrement modelée par l’amour, telle qu’il la décrit dans le Sermon sur la montagne. Comme l’a écrit David Bentley Hart dans notre numéro d'été 2019, intitulé Au-delà du capitalisme : « Les chrétiens sont ceux qui... n’ont plus le loisir d’imaginer ou désirer un ordre social, politique ou économique autre que la koinonia de l'Église primitive, aucune autre morale communautaire que l’anarchie de l’amour chrétien ».
Ce numéro de La Charrue vise à se mettre à l’écoute des gens qui ont vécu leur vie avec ce sens-là de la vocation. Une telle vie exige l’abnégation et la volonté de reconnaître tant ses propres forces supposées que ses faiblesses. Il s’agit d'un engagement à vie envers une Église de chair et de sang, comme l’évoque l’archevêque copte Angaelos (page 24). Cela peut même exiger d’être prêt à sacrifier sa vie, comme ce fut le cas d’Annalena Tonelli, humanitaire italienne pionnière du traitement de la tuberculose dans la Corne de l’Afrique (page 36).
Or, comme en témoignent aussi ces histoires, c’est une vocation qui apporte une joie plus profonde que toute autre voie choisie par soi-même. Les nombreux membres de notre société qui s’indignent de l’inutilité de leur travail ont quelque chose en tête : ils ont été créés, comme nous, pour découvrir objectif et sens supérieurs – la fameuse « condition de simplicité totale » chère à T. S. Eliot qui « ne coûte pas moins que tout ce que nous avons et sommes ». Ce n’est pas trop cher payé.
Traduit de l'anglais par Dominique Macabie