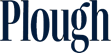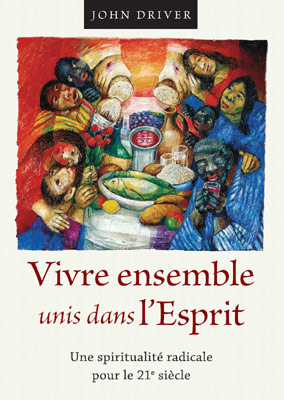Subtotal: $
Checkout
Petites femmes, Anges rebelles
Louisa May Alcott et Simone de Beauvoir
par Mary Townsend
mercredi, le 5 mai 2021
L’article suivant:
Simone de beauvoir n’est pas née athée, elle l’est devenue. Dans une inversion du Pari de Pascal, l’idée d’un quelconque marchandage avec Dieu lui semble mesquine et déplacée. Dans son autobiographie de 1958, « Mémoires d’une jeune fille rangée », elle écrit : « Je ne pouvais admettre aucune sorte de compromis avec le ciel. Lui cacher la moindre des choses, ce serait trop si Dieu existait ; et lui donner même très peu, ce serait encore trop s’il n’existait pas ». La logique du tout ou rien, la seule qui la satisfît.

Simone de Beauvoir Photographie appartenant au domaine public
Né en 1908, Beauvoir grandit dans l’épais brouillard de confusion émotionnelle typique du catholicisme français du XIXe siècle, et qui avait débordé dans la France d’avant-guerre. Elle fut éduquée dans le même type de religiosité immersive qui offrait tant de perspectives d’héroïsme spirituel, aux très jeunes filles en particulier ; le même type d’éducation qui produisit Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur, qui aspira à la sainteté dès son plus jeune âge et persista jusqu’à sa mort en 1897. Beauvoir, qui pendant plusieurs années avait ressenti l’appel d’entrer dans les ordres, décrit les transports sublimes des larmes versées dans le confessionnal et à s’imaginer en pâmoison dans l’étreinte d’un ange ; elle s’enorgueillissait d’inventer des mortifications pendant ses rares moments de solitude. Mais contrairement à Thérèse, Beauvoir ne trouva aucun réconfort durable au sein du christianisme, ni même à distance.
Ce n’est pas en se détachant des transports d’émotion ou en abandonnant le tout ou rien métaphysique qu’elle finit par trouver un portrait de l’âge adulte qu’elle puisse tolérer ; ni les attraits de la philosophie, d’abord découverts au travers du thomisme dans son école de jeunes filles, ni le groupe catholique avide de justice sociale pour lequel elle se porta volontaire, ne pouvaient faire l’affaire. C’est plutôt la littérature, comme forme artistique, et elle-même en tant qu’auteure, qui parvinrent à donner à cette vocation son attrait le plus fort et le plus durable. Difficile à croire, mais la première personne non sainte que Beauvoir trouva vraiment attirante fut la protestante américaine de fiction, Jo March, l’une des héroïnes du roman très populaire de Louisa May Alcott (1868), Little Women (Les Quatre Filles du Docteur March). Il était écrit que Beauvoir n’échapperait jamais au XIXe siècle.
Comme tant d'autres lecteurs, la jeune Simone s’est passionnément investie dans le personnage de Jo, l’écrivaine, reprenant le genre de la nouvelle pour l’imiter à sa manière. Inévitablement, elle avait aussi des opinions très arrêtées quant à Laurie, le riche voisin qui demanda en mariage l’une, puis l'autre, des sœurs March. En ouvrant par hasard le deuxième Tome de la quadrilogie, Good Wives (Les Filles du Docteur March se marient, elle tombe sur les fiançailles de Laurie et Amy (sans le contexte d’un Laurie éconduit par Jo), et sa réaction est aussi tranchée qu’immédiate : « J’ai détesté Louisa M Alcott pour cette raison ». Mais elle trouva poignantes les similitudes entre son style de vie familiale et celui des March (romancé, mais bel et bien inspiré du propre vécu d’Alcott) : « On leur a appris, tout comme à moi, qu’un esprit cultivé et droiture morale valaient mieux que l’argent ». C’était quelque chose à quoi s’accrocher, d’autant plus que, comme les March, et comme Alcott elle-même, la famille Beauvoir devait composer avec des moyens limités, le souvenir de temps meilleurs et la richesse, le confort trop ostentatoire de leurs voisins et relations. La récompense de leur vertu s’avéra tenir aux causes qu’elles embrassèrent : pour Alcott, l’abolitionnisme et les suffragettes, et pour Beauvoir, l’existentialisme, le marxisme et sa propre variété de féminisme : marxiste existentialiste. Simone, Louisa et Jo n’ont pas compris la nécessité d’une stricte circonspection sociale quant au comportement de leurs filles.

Louisa May Alcott
Ce drôle de métissage entre les vies d’Alcott et de Beauvoir continue de titiller mon sens du significatif, outre la coïncidence supplémentaire du film de Greta Gerwig et d’une nouvelle biographie de Beauvoir signée Kate Kirkpatrick, tous deux sortis l’année dernière. Le film est très beau, quoique je ne sois pas vraiment « entré dedans », moi qui suis pourtant fan ; moi aussi, j’ai lu avec plaisir Little Women (Les Quatre filles du docteur March) dans ma jeunesse, mais cette fiction ne m’est jamais apparue comme le reflet ou la version idéalisée de mon enfance. En fait, c’est seulement à la lecture des Mémoires d’une Jeune Fille rangée de Beauvoir que j'ai vécu une expérience de lecture analogue à celle que beaucoup évoquent à propos d’Alcott ; du fait que les descriptions de l’auteur semblent correspondre ou faire référence à certains de mes propres souvenirs. J’ai grandi dans l’ancienne colonie française de Louisiane, sous influence de l’Église Catholique romaine post-Vatican II ; comme Beauvoir, j’avais une sœur cadette, un parent très croyant et l’autre un peu sceptique, une grande famille élargie à qui rendre des visites régulières, une robe blanche à la première communion et le confessionnal hebdomadaire, prêt à absoudre même le plus véniel de mes péchés. Le monde d’Alcott, en revanche, m’était étranger. Que les March s’attachent tant à regretter leurs erreurs de conduite, qu’elles renoncent au vin (abstinence à vie, même pas à un mariage), qu’elles s’inquiètent tant de savoir si elles ont trop laissé libre cours à leurs passions – tout cela n’avait rien à voir avec l’esprit français, et n’aurait attiré aucun adulte de mon entourage. Pour moi, le monde protestant de ces Quatre Filles tenait plus du fantasme.
Simone trouve également quelque peu déroutant le protestantisme des March, unique fausse note dans leur correspondance par ailleurs si consensuelle. Elle lut Little Women dans le texte ; la traduction française (Les Quatre filles du docteur March) transformera M. March en médecin, concession obligée pour éviter le scandale d’un ecclésiastique pasteur, donc marié. Les March avaient leur Pilgrim's Progress (Le Voyage du Pèlerin), quand la mère de Beauvoir lui donnait à lire L’Imitation du Christ de Thomas à Kempis. Beauvoir fait sa première communion revêtue de tulle, tête couverte d’un voile de dentelle irlandaise (pas vraiment l’assortiment le plus en vogue dans la Louisiane des années 1980 – hélas pour l’époque). Mais la mortification permanente que Meg et Amy s’infligent devant la simplicité de leurs vêtements d’adolescentes, comme ceux de Simone à leur âge, voilà qui fut une vraie révélation sur le genre de vie et de religion que Beauvoir ne devait jamais pardonner. Un jour, une nouvelle élève débarque dans son école, mieux habillée que toutes les autres : « ses cheveux bouclés, son pull bien coupé et sa jupe plissée, ses manières sportives et sa voix désinhibée, autant de signes infaillibles qu’elle n’avait pas été élevée sous l’influence de saint Thomas d’Aquin ». Malgré la préférence de Simone pour Jo, elle est un peu Amy, de toute évidence ; elle conservera toujours un désir d’être belle, admirée, ce que Simone trouve touchant, raison supplémentaire de l’aimer, défaut pardonnable mais bien réel de sa propre personnalité. Dans ses romans, chacune des avatars romanesques de Beauvoir erre dans Paris et autour du monde entier, en quête perpétuelle de nouvelles façons d’être adorée.

Photos de l'adaptation cinémato-graphique de 2019 de Little Women de Greta Gerwig. Photographie d'imdb.com.
Zaza fut l’objet de l’adoration juvénile de Simone ; sa meilleure amie s’inscrit dans ses mémoires comme un contre-témoignage de ses propres rêves de rébellion. C’est ensemble qu’elles ont affronté leur scolarité d’adolescentes, dans une institution privée surnommée « Le Cours Désir », où le catholicisme justifiait des exigences aussi diverses que singulières. La mère de Zaza, qui avait aussi huit autres enfants, « aurait trouvé immoral d’acheter dans un magasin des produits qu’on peut fabriquer soi-même : gâteaux, confitures, sous-vêtements, robes et manteaux, entre autres ». Pas tant par souci d’économie – la sobriété financière était certes un idéal vertueux, mais inutile pour ces jeunes femmes censées épouser des hommes propriétaires des moyens de production ; c’était plutôt par souci d’avoir des occupations. En effet, leur vie se résumait à porter de beaux vêtements et à s’asseoir le dos bien droit dans des lieux de rencontre convenables : pas de quoi saturer toutes les heures du jour. Zaza est donc envoyée en ville avec mission de comparer le prix des tissus ; ou encore chargée de mettre en pots d’énormes quantités de confiture, de sorte qu’elle n’aura pratiquement pas le temps de parler à Simone. Dans Le Deuxième Sexe, Beauvoir est particulièrement virulente à l’endroit des pulsions destructrices suscitées par la préparation des confitures). « Zaza », écrit Beauvoir avec une pointe de jalousie, « était trop chrétienne pour seulement concevoir de désobéir à sa mère ». Certes, Zaza obéissait ; mais elle aussi avait néanmoins conscience de l’étrangeté des exigences de la religion, au nom même de la religion : « elle ne pouvait pas se résoudre à croire qu’en trottinant d’un magasin à un salon de thé, elle observait fidèlement les préceptes de l’Évangile ».
Les petites privations de la jeunesse parisienne de Beauvoir font pâle figure à côté de celles d’Alcott, dont la famille était non seulement indigente, mais souvent pauvre à cause de leur poursuite d’idéaux d'un autre monde ; pendant leur période « maraîchers », la rumeur voulait que le père d’Alcott leur eût interdit de cultiver des pommes de terre, en raison de leur nature par trop terrestre des tubercules. Mais certaines facettes de la vie d’Alcott auraient effectivement eu de quoi faire envie à Beauvoir. Son excellente instruction, Beauvoir en était redevable au fait que sa famille n’avait pas les moyens de la marier en fournissant une dot du montant habituel. On lui fit donc faire des études en vue d’un emploi dans l’enseignement. Son père considérait sa grande culture comme le reproche vivant d’un honteux échec personnel et il n’avait de cesse de lui répéter qu’elle lisait trop. Alcott, en revanche, avait pour père un utopiste raté, allergique à tout emploi salarié ; à ses heures philosophe, mais incapable de coucher sur le papier ses idées les plus prometteuses. Pas vraiment l’idéal pour sa progéniture, mais cette situation familiale présentait néanmoins quelques avantages : Bronson Alcott prenait au sérieux l’éducation de Louisa, et grâce aux liens de sa famille avec le transcendantaliste Ralph Waldo Emerson, l’abolitionniste William Garrison et le ministre unitarien Theodore Parker, le radicalisme, qu’il fut philosophique, politique radicale et religieux faisait naturellement partie de la vie de famille – et non une abomination que certains parents tentent frénétiquement de tenir à distance.
Pour moi, le monde protestant de Little Women tenait davantage du fantasme..
Beauvoir, et sa balbutiante conscience sociale, tenait de ses figures d’autorité que la condition des travailleurs était bien meilleure de nos jours. Plus tard, elle insistera pour s’en faire sa propre opinion, entreprenant de longs voyages pour observer les différentes conditions sociales des classes laborieuses ; ses visites en Amérique l’amenèrent à étudier les conséquences de la ségrégation, impulsion majeure à l’écriture du Deuxième Sexe. La philosophie – philosophie politique incluse – devint son moyen privilégié de révolte, par le prisme duquel comprendre sans concession la réalité, dans toute sa souffrance.
Alcott, en revanche, baigna toute sa jeunesse dans un christianisme radical en faveur des pauvres – non pour se contenter de leur venir en aide à l’occasion, mais réfléchir aux conditions sociales susceptibles, enfin, d’abolir la pauvreté elle-même. Cette liberté de faire l’expérience de la foi de cette manière fait partie du charme de la vie des quatre filles, mais on serait bien en peine de trouver dans leurs paroles le moindre signe d’une quelconque préoccupation abolitionniste. De son côté, la liberté prise par Beauvoir de laisser la politique prendre ouvertement part à ses travaux publiés pourrait bien faire envie à Alcott. Il est fascinant de voir comment les expériences religieuses de leur jeunesse, très similaires, furent accueillies de manière totalement différente par leur entourage. Alcott écrit : « Un sentiment très étrange de grande solennité m’a envahi, alors que je me trouvais là, sans autre son alentour que le bruissement des pins ; personne près de moi, et un soleil resplendissant, comme pour moi seule. Je me souviens avoir ressenti Dieu comme jamais auparavant, et prié de tout mon cœur pour retrouver toute ma vie la sensation exquise d’une telle proximité ». Un Unitarien y verrait une expression parfaitement raisonnable du christianisme. Beauvoir pour sa part, avait tenté de faire comprendre ce genre d’expérience, mais avait échoué à se faire prendre au sérieux, ce qui lui fit finalement perdre tout intérêt pour la religion.
Le principal écueil de la conception religieuse enseignée par Beauvoir, écrit-elle, c’est qu’elle exprimait la vérité d’une seule sphère de la vie observable, sans rapport avec une autre : « Sainteté et intelligence relevaient de deux univers bien distincts, et les réalités humaines – culture, politique, vie économique, mœurs et coutumes – étaient sans rapport avec la religion ». Au début, elle trouva ce cloisonnement simplement déroutant ; puis Simone se dit, « il y a quelque chose qui cloche ». Lorsque le pape Léon XIII prôna dans son encyclique Rerum Novarumun un salaire décent pour les ouvriers (position modérée qui désavouait tout ce qui aurait pu avoir l’air un peu trop inquiétant : socialisme ou abolition de la propriété privée), ses parents lui reprochèrent encore de « trahir sa sainte mission », contraignant ainsi leur fille à « se résigner au paradoxe suivant : l’homme désigné par Dieu pour le représenter sur terre ne devait surtout pas se mêler du temporel ». À l'université, cependant, Mme Beauvoir s’impliqua dans ces idées par le biais des travaux de son professeur Robert Garric, « catholique social » qui parlait d’offrir des opportunités culturelles et intellectuelles aux classes populaires. Elle admirait chez lui sa cohérence entre idées et vie concrète, inexistante ailleurs : « j’ai enfin rencontré un homme qui, au lieu de se soumettre au destin, s’est choisi un mode de vie ; son existence a un but et un sens, c’est l’incarnation d’une idée, et elle est régie par l’impérieuse nécessité de la matérialiser ». Mais jamais elle ne renonça à son penchant pour le tout ou rien, à sa « nostalgie de l’absolu » ; comme elle le déclara notoirement plus tard, même le socialisme ne suffisait pas, à son avis, à libérer les femmes ; il fallait faire la Révolution.
Beauvoir déplorait cette facette de sa personnalité, allant même jusqu’à s’en moquer : « un socialiste ne peut pas s’offrir une âme tourmentée ; il poursuit des objectifs à la fois laïques et limités : une telle modération m’a d'emblée irritée. L’extrémisme des communistes m’attirait beaucoup plus, mais je les soupçonnais d’être tout aussi dogmatiques et stéréotypés que les Jésuites ». Le roman de Beauvoir, Les Mandarins, publié en 1954, est un magistral condensé de la fragmentation et des faiblesses de la gauche, passionnément autocritique, dont les membres s’efforçaient désespérément de se fédérer, suite aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Et sa vie, consacrée autant à l’activisme qu’à l’écriture, illustre cette cohérence tant recherchée entre paroles et actes. Si elle sillonnait le monde à la rencontre des militants féministes et marxistes, elle écrivait des lettres interminables en réponse aux lecteurs du Second Sexe, elle marqua également les esprits dans son pays, en France : le journalisme de Beauvoir a contribué à faire pencher la balance de l’opinion publique française pour que cesse l’occupation coloniale d’Alger.
Le principal écueil de la conception religieuse enseignée par Beauvoir c’est qu’elle exprimait la vérité d’une seule sphère de la vie observable, sans rapport avec une autre.
La jeune Simone se sentait chez elle dans l’Église Catholique romaine de la Louisiane des années 1980 ; mais pas tant que ça, en fait. Personne n’exigeait des mortifications ; Rome était loin, et la France aussi ; la dernière religieuse de l'École de la Cathédrale de l'Immaculée Conception, Sœur Hélène, mourut un an trop tôt pour qu’elle soit ma professeur. C’est peut-être cette distance même qui permit à la Louisiane, lors du premier procès du genre organisé en 1984, d’obtenir la condamnation d’un prêtre qui avait sexuellement abusé de centaines d’enfants, dans le diocèse situé à quelques kilomètres seulement du mien – événement dont aucun adulte ne m’a parlé, pas une seule fois ; pourtant, on n'avait cesse de me mettre en garde contre les pédophiles. Dans le petit jardin devant notre église se dressait une statue de saint Vincent de Paul, patron du service aux pauvres ; je n’ai jamais su exactement pour quelle raison il était censé être si célèbre.

Photos de l'adaptation cinémato-graphique de 2019 de Little Women de Greta Gerwig. Photographie d'imdb.com.
Pour notre famille, le catholicisme était affaire de génétique ; certainement pas de moralité. Un certain nombre de règles, un peu plus complexes que celles des autres confessions (décriées chez nous), délimitaient ce qui était permis de ce qui ne l’était pas. Tout le monde vivait tantôt en respectant ces règles, tantôt les transgressant, au gré des circonstances ; si quelqu’un avait besoin d’une annulation, on finissait inévitablement par la lui octroyer, c’était juste une affaire de temps. À l’École Catholique, on nous enseignait comment justifier tant de complexité contre les accusations d'arbitraire ; cela formait en quelque sorte l’alpha et l’oméga de la théologie. Quelque chose ne tournait pas rond, oui, mais quoi ? Comme le dit Beauvoir, « j’avais des arguments subtils pour réfuter toute objection éventuelle aux vérités révélées ; mais je n’en connaissais pas un capable de les démontrer ».
Pour moi, le problème n’était pas tant la preuve ; l’épistémologie est la branche de la philosophie qui m’intéresse le moins ; il est beaucoup plus intéressant de tout savoir sur tout que perdre du temps à étudier la façon dont il est possible d’acquérir ces connaissances. Ce qui manquait était plus essentiel. À l’université, j’étudiais pour la première fois le livre de Martin Luther, De la Liberté d’un Chrétien (1520). Lorsque les arsouilles de la fête annuelle du campus ont interrompu notre séminaire après seulement quelques minutes, j’ai jeté mon exemplaire contre le mur sans le moindre scrupule. Je n’avais jamais lu un texte comme celui-ci ; au début, j’ai eu l’impression d’une totale vacuité de la pensée. Mais le lendemain matin, je suis retourné en classe pour repêcher ce bouquin qui gisait dans un coin ; ce n’était pas de l’apologie, mais quelque chose de plus simple. La vérité, quelle qu’elle soit, vous rendra libre. Ça me convenait.
Le plaisir que prenait Beauvoir à démolir tout ce qui a trait au religieux a pour moi un sens viscéral ; je sais exactement ce qu’elle ressentait parce que je l’ai vécu aussi. Tout balayer d’un revers de main, constructions artificielles, mépris apparent du corps féminin et sa rédemption par des blessures auto-infligées, insistance à défendre l’autorité humaine (masculine) pour cause d’intrinsèque sainteté et qu’en fin de compte on pouvait donc toujours lui faire confiance : la vérité était atteindre un but défini d’avance et parvenir à le justifier sans faire d’histoires.

Photos de l'adaptation cinémato-graphique de 2019 de Little Women de Greta Gerwig. Photographie d'imdb.com.
Pire : je ne pouvais gober l’histoire qu’il y aurait une saison pour faire son examen de conscience (malgré tout l’intérêt des saisons) et faire sans problème la bamboula le reste de l’année ; la jeunesse prend avec une légèreté déconcertante la puissance de la confession... C’est de constater ce petit jeu – céder au péché un jour et faire son petit saint le lendemain – qui met si mal à l’aise. Lorsque j’ai lu Platon pour la première fois, j’ai tout de suite été séduite : enfin quelqu’un dont le vécu atteste que la philosophie n’est pas à prendre un jour au sérieux pour se permettre n’importe quoi le lendemain : elle est à vivre, littéralement, au quotidien ; enfin quelqu’un qui détestait autant que moi l’amour de l’ignorance. Platon, cependant, fait notoirement référence à un bien qui certes imprègne le monde mais ne saurait en faire partie – tout à fait.
Après avoir annulé le donné, tout Hégélien digne de ce nom vous dira qu’il convient de faire une synthèse qui contienne à la fois le donné et sa négation, sous une forme plus subtile. Beauvoir, qui était par ailleurs bonne hégélienne et le savait pertinemment, n’en est jamais arrivée là au niveau du reniement de sa foi, parce qu’elle ne le souhaitait pas. Elle essayait de se satisfaire d’amours terrestres ; et nous aimons ses romans parce qu’on y lit son aveu que ça n'a jamais marché. Jeune fille, Beauvoir allait s’asseoir dans les églises pour jouir d’un moment au calme ; je fais toujours de même. Mais quel soulagement de ne pas devoir regretter de me laisser aller de bonne foi à désirer ce que cet édifice est censé abriter : ce qui, affirme l’athée avec un absolutisme insensé, ne saurait exister. Tandis que le Chrétien pense à ce dont, pense-t-il, tout le monde parle : Dieu – du moins est-ce ce que prétend Thomas d’Aquin, trop péremptoirement à mon goût. Être l’héritier, non pas du XIXe siècle, mais de la rébellion de Beauvoir, est un don immérité : je prends.
Finalement, une nuit, n’ayant pas réussi à invoquer Dieu directement, hic et nunc, elle décida de lâcher l’affaire.
Beauvoir était heureuse à l’université, bien qu’elle n’ait trouvé aucun auteur en qui avoir confiance en histoire de la philosophie ; l’interprétation de Platon qu’on lui proposa semble particulièrement peu inspirée, et il n’existait pas d’enseignement sur Hegel ou Marx. Elle pensait que la littérature était un meilleur moyen d’expression que la « voix abstraite » de la philosophie. Mais elle se sentait mal à l’aise avec l’écriture, car elle n’y voyait que vanité. À ce stade de sa réflexion, elle envisagea de se jeter dans le mysticisme – se saisissant d’un ouvrage de Plotin, elle tenta de se lancer dans une révélation directe de l’absolu. Dans les moments de parfait lâcher-prise, où l’univers semble réduit à un ensemble d’illusions et où mon propre ego est aboli, quelque chose prend leur place : quelque chose d’indestructible, d’éternel ; j’eus l'impression que mon indifférence trahissait la manifestation en creux d’une présence avec laquelle il n’est peut-être pas impossible d’entrer en contact. Elle demanda à ses pairs catholiques et à un professeur si elle était sur la bonne voie. Ils répondirent par la négative. Son confesseur lui avait fait quant à lui clairement comprendre et depuis longtemps qu’il n’avait aucune réponse à ses doutes.
Finalement, une nuit, n’ayant pas réussi à invoquer Dieu directement, hic et nunc, elle décida de lâcher l’affaire, concluant : « J’aurais dû détester l’idée que ce qui se passe ici-bas finisse par se retrouver dans l’éternité ». Son athéisme resta donc d’actualité. Mais cette remarque entre en contradiction avec sa conviction de l’importance de l’art et la promesse de longévité qu’il contient. Elle va donc à l’encontre de l’œuvre de sa vie.
C’est peut-être ainsi qu’elle exprime ses sentiments les plus sincères : « si je décrivais avec des mots un épisode de ma vie, j’aurais l’impression de le sauver de l’oubli ; qu’il pourrait en intéresser d’autres et donc lui épargner l’extinction ». Ce sentiment se retrouve étrangement dans le dialogue de Jo et Amy (tel que rendu dans le film de Gerwig), lorsqu’elles discutent des raisons pour lesquelles la narration de la vie familiale de quelques femmes pourrait revêtir une quelconque importance. En fin de compte, Beauvoir – l’artiste et le philosophe – s’accroche à ce genre d’éternité, c’est le moins qu’on puisse dire, et avec un brio qui non seulement me remplit d’amour, mais aussi de fierté – à son égard et de chacune des belles choses qu’elle a réussi à écrire, malgré leurs imperfections. J’éprouve la même fierté vis-à-vis d’Alcott, pour son œuvre autant que sa vie ; la même qu’on ressent au sujet de Jo. Ce n’est pas de la nostalgie mais de la fierté que j’ai ressentie en regardant le film de Gerwig : il n’a pas la perfection d’Alcott, ni dans l’autonomie esthétiquement momifiée de Gerwig-Jo ; fière qu'Alcott ait écrit, et que nous la lisions. Beauvoir ne s’est pas trompé sur l’art.

Photos de l'adaptation cinémato-graphique de 2019 de Little Women de Greta Gerwig. Photographie d'imdb.com.
Elle n'a pas appris la leçon de Jo, cependant – ou peut-être l’a-t-elle trop bien apprise : après tout, comme partenaire elle a choisi une Laurie, ou plutôt un professeur Bhaer (l’homme que Jo finit par épouser), Bhaer qui, dans son histoire conserve plusieurs aspects qui rappellent de façon suspecte les pires défauts de Laurie. C’est-à-dire que Beauvoir a trouvé Jean-Paul Sartre, et a conservé le besoin de le porter aux nues, même quand il ne le méritait pas. Et pourtant, comme le rappelle utilement la biographie de Kirkpatrick, Beauvoir était existentialiste et philosophe, bien avant que Sartre n’échoue à sa première tentative d’intégrer la Sorbonne – et qu’il sollicite son aide pour comprendre Leibniz, Husserl, Hegel, etc. Lorsque l’écriture de Beauvoir trébuche, c’est souvent parce que l’auteur y intègre une pointe d’apologie (ce qu’elle méprise par ailleurs), c’est-à-dire lorsqu’elle estime nécessaire de s’excuser pour Sartre. Que son écriture réussisse à s’en affranchir si souvent, comme elle l’a fait dans sa vie privée en se libérant rapidement de Sartre comme partenaire ou idole de vérité (après quelques mois passés ensemble, elle l’a déclaré ami de cœur, plutôt que sujet d’adoration permanente), témoigne de la réalité de son engagement pour la liberté, pour elle un bien suprême.
Sartre, dans sa philosophie, n’a jamais pu se défaire de sa lecture erronée, volontariste, de Hegel : vestige d’une erreur de jeunesse incorrigible. Cela se résume à la relation dialectique entre maître et esclave, chez Hegel : Sartre pensait que ce passage signifiait que l’être humain ne peut jamais se soustraire à son désir de dominer l’Autre, de quelque nature qu’il soit : l’étranger, le travailleur, votre amant, le passant croisé dans la rue... Beauvoir a écrit L'éthique de l'ambiguïté (1947) afin de défendre l’existentialisme contre l’accusation d'absence d’une éthique cohérente ; mais sa philosophie éthique atteignit sa cohérence dès qu’elle comprit ceci : ce n’est qu’en souhaitant la liberté de l’Autre qu’on parvient à une compréhension et une pratique authentiques de la liberté, à laquelle chacun de nous aspire. Cela se rapproche plus de ce que Hegel a réellement dit. Pourquoi Beauvoir, elle, a-t-elle su en faire son miel ? Elle écrit : « Mon éducation catholique m’a appris à ne jamais regarder un individu, aussi humble soit-il, comme un objet indigne de considération : chacun a le droit de réaliser ce que j’appelle son essence éternelle. » Beauvoir a gardé la foi qu’elle pouvait.
Je pense que Beauvoir a choisi l’athéisme parce qu’elle était incapable d’imaginer un christianisme intellectuel. Non pas tant du fait que l’intellectualisme était absent du thomisme ou de l’existentialisme catholique qu’elle avait connu, mais parce que ce qu’elle voulait, c’était la liberté d’un Chrétien : la liberté de comprendre Dieu ; la vérité ; l’Absolu à ses propres conditions, et on l’a convaincue que c’était impossible. Ironiquement, sa fascination de la vision de Sartre, qu’elle trouvait innovante, voulant qu’on ait la liberté de vouloir et forger son propre avenir, rappelle trop étrangement l’argument de Luther en 1520. Pour Beauvoir, le nationalisme aveugle de l’Église Catholique française, son soutien triomphal à la colonisation, son refus de remettre en cause la propriété privée, ne répondait pas à son désir de comprendre un monde asservi au capitalisme. Il faut donc considérer Beauvoir comme un ange rebelle.
Traduit de l'anglais par Dominique Macabie