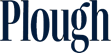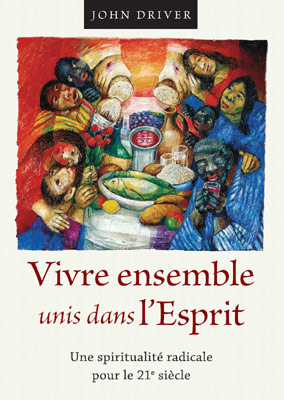Subtotal: $
Checkout
L’article suivant:
Les pandémies, au-delà de toutes leurs autres conséquences, nous montrent que nous ne sommes pas seuls. « No man is an island » (aucun homme n’est une île), comme le dit si bien la célèbre phrase de John Donne. Ça ne paraît jamais plus vrai que lorsqu’on essaie de se transformer en île et qu’on n’y parvient pas : ne pas pouvoir se tenir à un mètre de distance quand on rencontre un ami, se battre pour que les enfants gardent leurs masques, en frémissant de frustration parce qu’on n’a pas pu assister à un match des Mets.
La Covid-19 est la preuve que, oui, la société existe ; la maladie s’est répandue précisément parce que nous ne sommes pas des individus autonomes déconnectés les uns des autres : nous appartenons tous à un grand corps : l’humanité. La violence infligée par la pandémie est loin d’être équitablement répartie. Pourtant, elle révèle toujours plus clairement combien nous sommes mutuellement dépendants et combien il est urgent de porter les fardeaux les uns des autres. Face à ce dilemme – comment reprendre nos interactions sociales en toute sécurité – nous avons appris à quel point nous nous manquons les uns les autres. D’une manière inimaginable il y a à peine un an, les joies et les larmes de sept milliards de personnes – du moins quant à la propagation du virus dans l’attente d’un vaccin – sont aussi les nôtres.
C’est donc le bon moment pour parler de solidarité. D’autant plus qu’il s'agit d’un thème également soulevé par l’autre grand événement de cette année : suite à la mort de George Floyd, les manifestations internationales en faveur de la justice raciale. Il était étonnant de voir des foules scander « Black Lives Matter » dans des villes aussi éloignées des services de police des États-Unis : entre autres Stockholm, Séville et Sydney. C’était de la solidarité, ou du moins l’envie de quelque chose qui lui ressemble.

Les protestations ont également soulevé la question de la solidarité dans la culpabilité, même héritée depuis des générations. De nombreux manifestants ont exigé des réparations : les descendants des auteurs et des bénéficiaires de l’esclavage doivent rembourser une dette aux descendants des esclaves. Comment y parvenir en pratique ? C’est loin d’être clair, mais même les critiques de cette idée conviendront qu’en principe, les réparations peuvent être une réponse légitime à des torts historiques. Des millions d’Allemands nés après 1945 continuent de verser des réparations aux descendants de ceux que leurs arrière-grands-parents ont tués, sur l’argent de leurs impôts. Les initiatives de vérité et de réconciliation en Afrique du Sud et ailleurs cherchent à instaurer une sorte de justice intergénérationnelle. Aux États-Unis d’ailleurs, cette année, la Cour suprême est revenue sur un traité de 1833 et a reconnu que la moitié de l’Oklahoma est une terre tribale autochtone. Cet arrêt fait référence aux atrocités effroyables commises par le pays contre les Amérindiens. De diverses manières, chacun de ces exemples implique une revendication mettant en cause une responsabilité héritée – et peut-être une culpabilité héritée.
Ces revendications s’inscrivent dans une logique à laquelle s’oppose avec répugnance l’esprit libéral [au sens moral, pas économique du terme. NdT]. Il est formé pour ne penser qu’en matière de droits et de responsabilités individuels : Comment donc, à ce compte-là, puis-je être tenu pour responsable de maux sur lesquels je n’ai aucun contrôle ?
« Chacun est effectivement responsable envers tous les hommes, pour tous les hommes et pour tout. »
De nombreux chrétiens pourraient être enclins à accepter cette objection. Mais la tradition chrétienne répond : pas si vite. En fait, le christianisme prend très au sérieux la solidarité dans la culpabilité, même héritée et depuis des générations. Selon l’apôtre Paul, toute l’humanité a péché et a été condamnée dans le péché de notre ancêtre Adam : « Car, comme en Adam, tous meurent... » (1 Cor. 15). Si l’on parle du « péché originel » d’Augustin, de la « direction fédérale » des réformateurs, ou de l’ « Adam total » des penseurs orthodoxes, ce n’est pas un thème que les chrétiens ont le droit de balayer d’un revers de main.
L’exploration la plus vivante de ce type de solidarité est le roman de Fyodor Dostoïevski, Les frères Karamazov. Dostoïevski y évoque un adolescent mourant confiant à sa mère : « Chacun de nous a péché contre tous les hommes... Chacun est effectivement responsable envers tous les hommes, pour tous les hommes et pour tout. »
La responsabilité de tous et envers tous : à première vue, cela semble absurde. Sa logique nous entache tous de la culpabilité non seulement de ceux que nous connaissons et que nous pourrions théoriquement influencer, mais aussi des péchés de personnes que nous ne rencontrerons jamais et d’autres mortes depuis longtemps (un cynique pourrait ajouter que si nous sommes tous responsables de tout, cela revient, dans le monde réel, à dire que personne n’est responsable de quoi que ce soit).
Pourtant, ces paroles de Dostoïevski ne sont pas seulement les ruminations d’un romancier excentrique. Elles sont reprises presque mot pour mot dans l’une des plus grandes déclarations de l’enseignement social chrétien moderne, l’encyclique Sollicitudo rei socialis du pape Jean-Paul II (1987). La solidarité, écrit le pape, « n’est pas un vague sentiment de compassion ou de détresse superficielle face aux malheurs de tant de personnes, proches ou lointaines. Au contraire, c’est une volonté ferme et persévérante de s’engager pour le bien commun, c’est-à-dire pour le bien de tous et de chacun, car nous sommes tous réellement responsables de tous »

C'est là la solidarité authentique, C’est le contraire des fausses solidarités de la politique identitaire d’aujourd'hui, tant de droite que de gauche. Qu’elles soient simplement racistes ou prétendument antiracistes, ces fausses solidarités considèrent avant tout les gens comme porteurs d’une ou plusieurs identités de groupe fondées sur la nationalité, la race, la classe ou le sexe – et considèrent ces groupes identitaires comme inévitablement antagonistes, pris avec les autres groupes dans une lutte acharnée pour le pouvoir. Ici, la « justice » ne signifie guère plus qu’un équilibre tendu entre les intérêts des groupes. Par conséquent, ceux qui adhèrent à une telle vision du monde sont susceptibles de recourir à la coercition et même à la violence, comme l’illustrent les épisodes horribles de certaines des manifestations de l’été dernier.
En revanche, le christianisme – avec le judaïsme et d’autres religions – enseigne que les gens sont avant tout porteurs de l’image divine. Chacun de nous partage avec tous les autres le lien fondamental de notre humanité commune. C'est pourquoi l’Évangile condamne totalement l’oppression d’un groupe par un autre, y compris l’ensemble de l’édifice démoniaque de la suprématie blanche (voir page 10). Mais pour la même raison, il refuse de combattre le feu par le feu, en combattant l’intérêt personnel d’un groupe par l’intérêt personnel d’un autre. Elle offre plutôt la voie de la solidarité dans la culpabilité dont parlent Jean-Paul II et Dostoïevski.
Cette voie n’est pas une sinistre invitation à d’interminables séances de lutte pour la négation de soi. En cela, elle ne pourrait pas être plus différente de l’essentialisme racial de best-sellers tels que White Fragility (la fragilité des blancs) de Robin Di Angelo. Rien à voir. C’ « est plutôt une porte s’ouvrant sur la redécouverte de la glorieuse vocation que nous partageons avec tous les êtres humains ».
En assumant notre culpabilité commune avec toute l’humanité, nous devenons solidaires de celui qui la porte sur lui et la rachète. « Car comme en Adam tous meurent, poursuit Paul, de même en Christ tous seront rendus à la vie ». Dans le Christ, les péchés sont pardonnés, la culpabilité abolie et une nouvelle façon de vivre ensemble devient possible.
Cette solidarité dans le pardon – la solidarité que le Christ a assumée avec nous – donne naissance à une vie d’amour. C’est la raison pour laquelle un autre personnage des Frères Karamazov disait, « Quant à la culpabilité de chacun pour tout et devant tous, outre pour ses propres péchés... quand les gens comprendront cette pensée, le royaume des cieux viendra à eux, non plus en rêve, mais en réalité »
Il y a cent ans cette année, dans une Allemagne brisée par la guerre et la révolution, un groupe de discussion se réunissait chaque jeudi soir dans une maison de ville à Berlin pour imaginer une nouvelle façon de vivre, façonnée par ce type de solidarité. Comme le décrit Antje Vollmer (page 39), les jeunes participants étaient très divers : évangéliques et anarchistes, militaires et pacifistes, artistes et quakers. Dans un pays ruiné par nationalisme, militarisme et exploitation, les paroles de Dostoïevski sur la responsabilité pour tous et envers tous les citoyens ont frappé les esprits avec force. Ils ont notamment lu le Sermon de Jésus sur la montagne. Ils y ont trouvé un Dieu qui nous invite à un mode de vie pratique et créatif dans lequel notre solidarité dans la culpabilité se transforme en un nouveau type de solidarité tandis que nous travaillons côte à côte pour construire le nouvel ordre social décrit dans les évangiles.
À la fin d’un de leurs rassemblements au printemps 1920, une jeune femme se leva et déclara, « Assez parlé. Il est maintenant temps de passer à l’action ». Eberhard et Emmy Arnold, le couple qui animait ces soirées, ont pris ses paroles à cœur. Il a démissionné de son emploi dans une maison d'édition chrétienne et a vendu sa police d’assurance-vie ; Emmy a installé leurs cinq enfants dans une maison délabrée de Sannerz, village perdu dans l’arrière-pays. Avec la sœur d’Emmy, Else von Hollander, ils fondèrent une communauté de peuplement inspirée par l’exemple des premiers chrétiens et, avec des amis, une nouvelle maison d’édition du nom de Neuwerk : nouvelle l'œuvre. Au cours des décennies suivantes, la maison d’édition prendra le nom anglais de Plough (charrue), et l’établissement communal deviendra le Bruderhof, la communauté qui publie ce magazine.
Dans le même esprit que le groupe de discussion de Berlin il y a un siècle, ce numéro de La Charrue cherche à explorer le sens de la solidarité, et ce que signifie la vivre aujourd’hui, que ce soit en Ouganda, en Bolivie ou en Corée du Sud, dans une église urbaine, voire Bruderhof ou un couvent. Nous sommes impatients de savoir ce que vous en pensez.
Traduit de l'anglais par Dominique Macabie