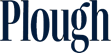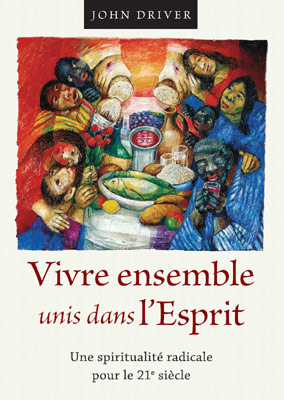Subtotal: $
Checkout
L’article suivant:
Ces parents qui s'inquietent beaucoup pour leurs enfants m’ont toujours agacé. Je trouvais paranoïaques ces parents toujours inquiets d’entendre sonner le téléphone et d’apprendre de terribles nouvelles. Mes six enfants ont eu leur lot de plaies et bosses, mais sont toujours retombés sur leurs pieds. J’ai fait confiance à leur bon sens et à la Providence. Accidents, maladies, malheurs – d’autres familles étaient frappées, jamais la mienne. Alors quand un jour le téléphone a sonné, je n’étais pas préparée.
C'était une de ces belles journées de novembre où la nature déploie une dernière fois son charme estival. Mon mari, Felix, et moi avions roulé six heures dans le nord de l’État pour assister à la rencontre de cross-country de notre plus jeune fils. Après cette course où il s’était bien placé, nous avons poussé jusqu’à Potsdam, New York, pour rendre visite à nos deux filles, étudiantes à la Crane School of Music, et passer la nuit dans la maison qu’elles partageaient avec des amies. Après le bon dîner que nos filles avaient préparé, nous nous sommes détendus dans le salon. Dehors, un ciel bleu clair se nuançait de rose et s’assombrissait – la fin d’une journée parfaite.
Et puis le téléphone de mon mari a sonné.
À peine quelques semaines, plus tôt, par une soirée tout aussi délicieuse, lui et moi étions en train de déguster du bourbon sur le pont d’un navire. Je me suis tournée vers lui pour lui dire : « C’est tellement parfait qu’on dirait qu’il manque quelque chose »
« C'est étrange de dire une chose pareille », avait-il répondu, « mais je pense savoir ce que tu veux dire »
Au cours des mois précédents, un sentiment d’agitation m’avait envahie. Cela faisait maintenant trente ans que nous nous étions mariés au Bruderhof, la communauté à laquelle nous appartenons et où Felix est pasteur, et nous avions l’impression d’avoir reçu tout ce dont nous avions rêvé. Nos enfants étaient en bonne santé, populaires, débordants de talents… La plupart étaient déjà des adultes autonomes ou à l’université ; notre fils aîné s’était marié et nous avions déjà notre premier petit-fils. Je me disais que nous avions joui d'une vie enchanteresse. Était-ce de la chance ? Une bénédiction ? Ou bien les ennuis nous avaient-ils passé notre tour ? C’était un sentiment mitigé, mais je me sentais incomplète. Pendant le ministère de Félix, nous avions conseillé de nombreuses personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la communauté, notamment pendant les deux années où nous avions servi dans l’East End, quartier déshérité de Londres. D’innombrables fois, nous avions rencontré des personnes en deuil, comme écrasés sous la meule de la vie. Nous avions toujours fait de notre mieux pour les consoler, mais nos paroles sonnaient souvent à mes oreilles comme de pieuses platitudes. Mes phrases de réconfort, si bien intentionnées, sonnaient faux, même à mes propres oreilles.
« Felix, m’étais-je dit, notre mariage a été si béni. Nous n’avons jamais eu à faire face à des situations très difficiles. Penses-tu que Dieu pourrait nous en demander plus ? »
Maintenant, lors d'une autre soirée parfaite, Felix a décroché son téléphone. Correspondant non identifié. « Demi-pension de Joe », a-t-il dit en plaisantant. Nous avons tous ri. Puis son visage s’est soudain tendu. « Pouvez-vous répéter ? » demanda-t-il.
Félix m’a fait signe de m’approcher et nous avons eu beaucoup de mal à comprendre l’interlocuteur. Il s’agissait de Rudi, notre avant-dernier fils, notre jeune de dix-neuf ans, qui nous avait quitté avec tant d’enthousiasme six mois plus tôt pour enseigner l’anglais à des enfants indigènes du Paraguay. Nous n’avons perçu que des bribes. Rudi avait eu un accident – chute d’une falaise – hospitalisation – coma – état critique.
Soudain, le ciel d’automne est devenu aussi froid que la glace. Ma peau s’est mise à fourmiller et ma tête à tourner. Notre esprit s’est vidé de toute pensée, sauf pour notre fils. Nous sommes rentrés à toute vitesse et avons réservé le premier vol pour Asunción, au Paraguay.

Rudi, dix ans, projet en cours.
Toutes photos utilisées avec l'aimable autorisation de l'auteur
Tout au long du voyage, je fus assaillie par un kaléidoscope brutal d’images pénibles. Mais je parvenais malgré tout à voir le visage de Rudi et son sourire légèrement en coin. Il avait toujours été le moins exigeant de nos enfants : radieux et toujours content, la tête pleine des projets qu’il avait échafaudés. Je l’ai revu au milieu du salon, ses bottes laissant des traces de boue sur le parquet, tout fier de me rapporter deux bottes de radis fraîchement récoltés dans son jardin « bio », créé sous l’escalier de secours. Je l’ai revu assis sur son lit, à essayer de fixer les sangles en caoutchouc de sa dernière catapulte. Je l’ai revu au milieu des babioles qu’il chérissait enfant : pièces d'échec sous le lit ; timbres tombés de son album égarés sur son bureau ; bouts de métal qu’il avait ramassés, en attente de recyclage dans sa forge artisanale ; ses carnets sur la commode, sur la table de nuit, sous la table de nuit – des carnets de poésies inachevées, de nouvelles à moitié terminées, de blagues, de notes dans son journal intime.
Je l’ai revu adolescent – échalas dégingandé, et son sourire inaltérable en toutes circonstances. Contrairement à mes autres enfants, il n’avait jamais cultivé un esprit de compétition. Je voulais qu’il fasse du sport au lycée, et l’ai encouragé à s’essayer au foot. Il est parti passer les tests et était tout content à son retour de m’annoncer qu’il n'avait pas réussi à intégrer l’équipe. « L’entraîneur nous a fait courir autour du terrain, expliqua-t-il, mais l’un des gars n’arrivait plus à suivre, alors je suis reparti en arrière pour courir avec lui. Je suppose que ça n’a pas plu à l’entraîneur ».
J’ai revu les nombreux petits cadeaux qu’il m'avait faits au fil des ans : les porte-jardinières et la grille pour mes pense-bêtes qu’il avait façonnés à partir de bouts de ferraille, un beau bracelet filigrané astucieusement tissé avec du fil de soudure.
Je me suis rappelé la dernière fois où je l’avais vu. Il vivait chez des amis loin de son lieu de travail. Un soir, sans crier gare, il a fait irruption dans notre salon en annonçant : « Je m’en vais ! Je pars demain pour le Paraguay ! » Il était en extase.
Nous savions que Rudi s’était porté volontaire pour enseigner dans une école pour enfants indigènes dans le Chaco, et étions donc très heureux pour lui.

Je n’arrive pas à croire qu’il ait mordu à l’hameçon ! Rudi (au centre).
Assise dans l’avion, la tête pleine du visage de Rudi mais incapable d’imaginer le Rudi que j’allais voir, j’ai ouvert l’un de ses carnets que j’avais dans mon sac à main. Dans son écriture unique et saccadée, l’un de ses poèmes s’intitulait « Graduation » (remise des diplômes), écrit juste avant la fin de ses années lycée et son départ de chez nous..
Vous, fleurs privilégiées de pousser
Sur le rebord de ma fenêtre,
Protégées de la tempête et du vent,
Exemptées de toute épreuve,
De tout chagrin et de tout frisson,
Jamais tentées, jamais aux prises avec le péché.
Du haut de votre trône élevé,
Vous regardez avec mépris
Les membres de votre famille
Qui s’ébattent loin en bas.
Comme un empereur, un millionnaire,
Immunisées contre prédateurs et ennemis.
Un jour, vous sortirez de votre abri de plastique
Et tomberez dans la saleté du monde naturel,
Sans protection contre la maison des brindilles.
Trouvez des choses qui guérissent
Autant qu’elles blessent.
Et entre les mondanités,
Vous découvrirez qu’éprouver de la joie
Exige d’endurer la douleur.
Arriver à Asuncion c’était comme entrer dans un sauna. Nous étions désorientés, non seulement à cause de la chaleur, mais aussi de la culture étrangère et d’une langue inconnue. Un ami de Rudi nous a emmenés à l’hôpital et nous a raconté ce qui s’était passé. Rudi était tombé de quinze mètres en escaladant une falaise abrupte sans se faire assurer. Il avait été transporté à l’arrière d’une camionnette et avait enduré pendant deux heures une agonie extrême jusqu’à l’hôpital où les médecins l’ont mis en coma artificiel.
Quand nous sommes arrivés à l’hôpital, j’ai résolu d’être forte, mais rien n’aurait pu me préparer à la vue du corps brisé de Rudi, enveloppé d’appareils respiratoires, de plâtres et de tout un enchevêtrement de fils et de tubes. Sa poitrine se soulevait et s’abaissait mécaniquement, sous l’effet du ventilateur. Je ne sentais plus rien. J’étais brisée. Comment tout cela était-il possible ?
Mais mon raisonnement optimiste fit son effet. Rudi était le plus dur de la famille, me suis-je dit, celui qui ne se plaignait jamais. Grand, fort, beau – il avait toujours manifesté un grand amour de la vie. Si quelqu’un dans notre famille pouvait survivre à cela, ce serait Rudi. Il se battrait comme un lion. Mais si loin du monde qui nous était familier, nous nous sentions totalement impuissants.
Dans notre malheur, nous avions le précieux soutien de notre communauté. Ils ont contacté notre compagnie d’assurance et ont organisé l’évacuation sanitaire de Rudi vers les États-Unis. Après plusieurs revers, une date de transfert a été fixée. Grâce à l’interprète, Felix et moi avions compris que les médecins paraguayens estimaient que Rudi avait de bonnes chances de survivre. Notre espoir et confiance ont grimpé en flèche. Une fois Rudi transféré aux États-Unis, tout allait bien se passer.
J’ai embrassé son front – le seul endroit épargné par l’attirail médical. On nous a ensuite fait sortir et les médecins ont commencé la préparation de Rudi pour son dangereux voyage.
Après chaque étape du vol, des messages SMS de l’infirmière à bord du jet nous informaient que tout allait bien. Le vol s’est posé sans encombre à Albany, New York, et les chirurgiens ont immédiatement programmé de le sortir du coma avant d’entamer une série d’opérations de chirurgie reconstructive.
Felix et moi avions prévu de suivre sur un vol commercial, mais notre vol fut annulé pour cause de violents orages. Après des retards exaspérants, nous avons pris un autre vol et atterri à JFK trois jours plus tard, en pleine tempête de neige. Nous sommes sortis de l’avion et avons attendu notre tour pour le contrôle douanier. Nous étions debout, serrés les uns contre les autres avec des inconnus, dans le bruit avec les douaniers qui aboyaient des ordres quand le téléphone portable de Felix a sonné. Un SMS de notre médecin de famille : « Rappelez immédiatement ».
Mon cœur battait la chamade. Instantanément, j’ai ressenti cette prémonition qui vous noue le ventre – une terrible nouvelle nous attendait. Et, une fois de plus, je me suis préparée au pire. Peut-être n'était-ce qu’une question en rapport avec l’opération... Dans l’aéroport, les gens bavardaient autour de nous, la vacarme ponctué par les annonces de l’interphone.
Devions-nous appeler ici ou attendre d’avoir plus d'espace pour parler en toute intimité ? Félix hésita, puis composa le numéro.
La voix de notre médecin, généralement calme et aimable, était tendue et haletante. « Venez aussi vite que possible », a-t-il dit. « L’état de Rudi est extrêmement critique ». Nous étions stupéfaits. Il devait y avoir une erreur. Les médecins du Paraguay avaient dit qu’il était stabilisé. Nous l’avons assailli de questions et avons appris qu’une brusque altération au niveau des fluides internes venait d’enrayer toute activité cérébrale. Les médecins d’Albany ne lui donnaient que quelques heures.

Rudi avec des amis au Paraguay
Nous étions là, plantés au milieu de la foule, hébétés. Nous avons passé la douane et sommes allés d’un pas mal assuré récupérer nos bagages. Le carrousel s’était coincé ; les voyageurs frustrés s’impatientaient. Quel intérêt, ces bagages, de toute façon ? Notre fils était mourant. Nous allions partir sans eux mais c’est alors que le carrousel s’est remis en marche, et nous avons retiré nos quatre valises à toute vitesse. Nous les avons chargées sur un chariot et fait signe à la limousine. Le chauffeur ne cessait de bavarder et ces quatre heures de route nous ont semblé une éternité.
Enfin, en entrant dans l’unité de soins intensifs d’Albany, nous avons vu notre fils. À cet instant, j’ai senti que l’âme de Rudi n’était plus avec nous ; il était déjà dans un autre monde. Son âme, toujours pleine de vie et d’énergie, s’était débarrassée de ce corps estropié et brisé et s’en était allée. Il volait, il était libre. Je le sentais me donner un coup de coude et me sourire, comme pour me dire : « Ne sois pas triste, mon travail ici est terminé ».
Ce soir-là, toute notre famille s’est réunie autour de son lit. Allan, le frère aîné de Rudi, dirigeait nos chants avec sa guitare, et prenait la relève lorsque les sanglots noyaient la mélodie. La boîte de mouchoirs était vide. Toute la nuit, les trois frères de Rudi sont restés avec lui – leur dernière chance de passer du temps ensemble. Ils se sont remémoré leur enfance, ont chanté les chansons préférées de Rudi, lui ont lavé les cheveux et lui ont rasé le menton.
Le lendemain matin, nous nous sommes réunis à nouveau pour débrancher le respirateur. Il était 4 heures du matin, le 4 décembre.
Après l'enterrement, les jours se sont écoulés comme dans un brouillard. Je me sentais faible et vide. Toutes les certitudes de mon ancienne vie se sont évaporées. Si un stupide accident pouvait me priver de mon fils, alors la vie reposait sur une aile de papillon.
Dans ce vide solitaire se sont déversés des centaines de courriels, cartes et textos des amis et camarades de classe de Rudi des quatre coins du monde. Ils me parlaient d’une facette de Rudi dont je n’avais guère eu conscience. Un de ses camarades de classe écrivit : « C’était bien le seul gars parmi mes copains du lycée qui se fichait royalement de se la jouer « cool » et qui cherchait toujours à tendre la main aux élèves marginalisés et solitaires. Une jeune femme raconta : « Rudi cherchait à aider tout le monde, mais j’ai bien l’impression d’en avoir bénéficié tout particulièrement. Je détestais le lycée. J’avais du mal à m’accepter, à trouver ma place, et je pense que Rudi l’avait compris. Une fois, il m’a rencontrée dans une salle et m’a conseillée d’intégrer la chorale de gospel parce que, pensait-il, j’avais des chances de faire une bonne soliste. Il m’a dit qu’il aimait ma voix et me trouvait parfaite pour ce rôle. Ouah ! Ça m’a permis de tenir le coup pendant au moins deux semaines ».
Tous ces témoignages formulés par des personnes du monde entier partageaient le même thème : Rudi, notre fils, lui si impulsif et souvent déroutant, cherchait une vie authentique, sans hypocrisie et loin des fausses valeurs – une vie vécue non pas pour lui-même, mais pour les autres. Plus nous découvrions cette facette de notre fils, plus le sentiment de notre perte empirait. Mais nous sentions aussi que, d’une certaine manière, aussi brève qu’elle avait été, la vie de Rudi avait été bien remplie ; il avait atteint son but. C’est sans doute Rudi lui-même qui a le mieux exprimé notre sentiment dans la dernière strophe du dernier poème reçu de lui :
Quand la vie d'un homme transcende
Ce monde maléfique et s’en démarque,
Quelle que soit la façon dont il atteint sa fin,
Il inflige une entaille au cœur de Satan.

Néanmoins, même avec cette assurance fondée sur notre foi, le chagrin nous a terrassés. Nous regardions nos amis poursuivre activement leur vie, absorbés par les détails des tâches quotidiennes ; quant à nous, rien de notre vie d’avant ne semblait avoir de sens. Chaque jour ressemblait à un gouffre vide qu’il nous fallait enjamber. Noël n’était plus qu’à quelques jours. Les célébrations, la bonne humeur et la gaieté typiques des fêtes de fin d’année remuaient le fer dans la plaie de nos âmes blessées. Comment survivre à tout ça ?
C’est alors que nous a appelés le père de jeunes adolescents, qui venait de perdre sa femme des suites d’un cancer. Il nous a invités à nous joindre à sa famille pour le dîner de Noël. Nous les connaissions à peine mais avons accepté, et nous sommes immédiatement liés d’amitié. Nous avons passé six heures ensemble, à partager des images et à raconter des souvenirs, à pleurer et à rire. Notre chagrin commun nous a rapprochés, nous liant aux autres d’une manière sans précédent pour nous. À la fin de la soirée, la conversation se prolongea dans un silence apaisant. Pendant plusieurs minutes, nous avons regardé par la grande baie vitrée le coucher du soleil qui déroulait des cascades de lumière dorée dans la vallée de l’Hudson. Implicitement, nous savions que nos proches étaient vivants dans l’éternité, dans l’attente de futures retrouvailles.
Quelques jours plus tard, un couple plus âgé dont le fils de vingt-deux ans était mort d’un cancer est venu faire son deuil avec nous. Peu après, une femme d’âge mûr est venue nous raconter son histoire (c’est elle qui avait trouvé sa sœur morte, après son suicide) ; puis ce fut au tour d’un jeune couple dont le fils en bas âge était mort quelques heures après sa naissance. À chaque rencontre, nous avons pleuré et ri ensemble, car notre chagrin commun faisant tomber toutes les barrières.
jésus a dit, « Heureux les affligés » (Mt 5, 4). Cette béatitude m’a souvent laissée perplexe : comment le deuil peut-il être une bénédiction ? Maintenant, à travers la mort de Rudi, aussi difficile qu’il soit de l’admettre, je peux dire que le deuil que nous faisons chaque jour est une bénédiction. Il nous a rapprochés de tant d’autres personnes. Déjà, à l’hôpital d’Asunción, des étrangers avec lesquels nous ne pouvions même pas parler s’asseyaient et pleuraient avec nous. Ils avaient vu notre vulnérabilité et nos blessures, et ont réagi selon leur propre cœur blessé. Nous n’avons jamais su quelle douleur ils enduraient ; nous savons seulement qu’ils en éprouvaient une et comprenaient la nôtre.
Le vague sentiment d’incomplétude que je ressentais avant la mort de Rudi m’a quitté. Difficile d’expliquer comment ont peut se sentir comblé suite à une perte : Rudi m’a laissé un indice avec les derniers mots de son poème, « la joie exige la douleur ».
Peut-être avait-il compris à dix-huit ans ce que je n’apprends que maintenant. Depuis sa mort, j’ai compris que Jésus est ici, au fond de la société, au milieu de tous ceux qui souffrent. J’ai appris que notre douleur adoucit la carapace qui nous isole de la souffrance des autres. Notre chagrin nous permet d’absorber leur peine, nous faisant ainsi participer à la souffrance collective du monde, une souffrance connue et portée par Dieu lui-même. Dans ce lien si profond et intense avec les autres, j’ai trouvé la joie.
Traduit de l'anglais par Dominique Macabie
Emma Meier et son mari, Felix, vivent à la Mount Community, un Bruderhof à Esopus, New York.